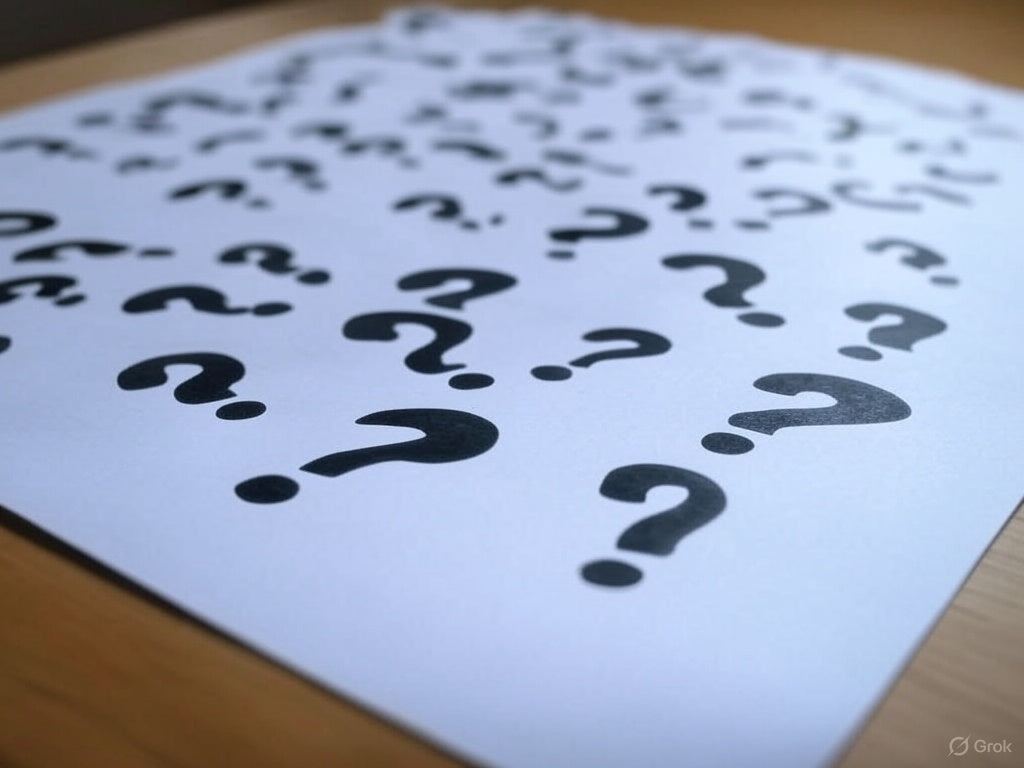Introduction et contexte
Le 3 avril 2025, le président Donald J. Trump a dévoilé une vaste série de droits de douane à l'importation dans le cadre de sa politique commerciale « réciproque » visant à réduire les déficits commerciaux des États-Unis et à stimuler l'industrie nationale. Ces mesures comprennent un droit de douane général de 10 % sur toutes les importations aux États-Unis , associé à des droits de douane beaucoup plus élevés ( Top News | KGFM-FM ) pour les pays qui affichent d'importants excédents commerciaux avec les États-Unis. En pratique, cela signifie que la quasi-totalité des partenaires commerciaux des États-Unis sont concernés . Par exemple, les importations en provenance de Chine sont désormais soumises à un droit de douane punitif de 34 % , celles de l'Union européenne à 20 % , du Japon à 24 % et de Taïwan à 32 % , entre autres. Le président Trump a justifié ces droits de douane en déclarant l' état d'urgence économique nationale en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA), invoquant des décennies de déséquilibres commerciaux qui, selon lui, ont « affaissé » le secteur manufacturier américain. Les droits de douane sont entrés en vigueur début avril 2025, suivis des taux « réciproques » plus élevés le 9 avril, et resteront en vigueur jusqu'à ce que l'administration estime que les partenaires commerciaux étrangers ont remédié à ce qu'elle considère comme des pratiques commerciales déloyales. Quelques produits essentiels sont exemptés, notamment certaines importations liées à la défense et des matières premières non produites aux États-Unis (comme certains minéraux, ressources énergétiques, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, bois d'œuvre et certains métaux déjà soumis à des droits de douane antérieurs).
Cette annonce, décrite par Trump comme un « jour de libération » pour l'industrie américaine , représente une escalade bien supérieure aux droits de douane de son premier mandat. Elle érige essentiellement un nouveau mur tarifaire mondial autour des États-Unis, affectant pratiquement tous les secteurs et pays impliqués dans le commerce avec les États-Unis. L'analyse suivante examine les impacts attendus de ces droits de douane au cours des deux prochaines années (2025-2027) sur l'économie mondiale et les marchés américains. Nous examinons les perspectives macroéconomiques, les effets sectoriels spécifiques, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les réponses internationales et les conséquences géopolitiques, les impacts sur le travail et les consommateurs, les implications pour les investissements et la manière dont ces mesures s'inscrivent dans le contexte historique de la politique commerciale. Toutes les évaluations sont basées sur des sources crédibles et actualisées et sur les analyses économiques disponibles à la suite de l'annonce d'avril 2025.
Résumé des tarifs annoncés
Portée et échelle : Le cœur du nouveau régime tarifaire est une taxe à l'importation de 10 % appliquée universellement à tous les pays exportant vers les États-Unis. De plus, l'administration ( Fiche d'information : Le président Donald J. Trump déclare l'urgence nationale pour accroître notre avantage concurrentiel, protéger notre souveraineté et renforcer notre sécurité nationale et économique – Maison Blanche ) a imposé des surtaxes tarifaires individualisées à des dizaines de pays, proportionnelles au déficit commercial des États-Unis avec chacun d'eux. Selon les termes du président Trump, l'objectif est d'assurer la « réciprocité » en facturant aux exportateurs étrangers des frais proportionnels à la différence entre leurs ventes et leurs achats aux États-Unis. En effet, la Maison Blanche a calculé des taux de droits de douane destinés à générer des recettes à peu près égales à chaque déséquilibre commercial bilatéral, puis les a divisés par deux, dans un geste de prétendue clémence . Même à la moitié du niveau théorique de « réciprocité », les droits de douane qui en résultent sont énormes par rapport aux normes historiques. Les principaux éléments du dispositif tarifaire comprennent :
-
Tarif de base de 10 % sur toutes les importations : À compter du 5 avril 2025, toutes les marchandises importées aux États-Unis seront soumises à un droit de douane de 10 %. Ce tarif de base s’applique à tous les pays, sauf s’il est remplacé par un taux plus élevé spécifique à chaque pays. Selon la Maison-Blanche, les États-Unis ont longtemps eu l’un des taux tarifaires moyens les plus bas (environ 2,5 % à 3,3 % NPF), tandis que de nombreux partenaires appliquent des tarifs plus élevés. Le tarif général de 10 % vise à rétablir cet équilibre et à générer des recettes.
-
Tarifs « réciproques » supplémentaires ( la vague de tarifs douaniers de Trump du 2 avril pourrait paralyser les économies en développement | PIIE ) : À compter du 9 avril 2025, les États-Unis ont appliqué des surtaxes importantes sur les importations en provenance de pays avec lesquels ils affichent d'importants déficits commerciaux. Dans l'annonce de Trump, la Chine est la cible principale avec 34 % (base de 10 % + supplément de 24 %). L'UE dans son ensemble est confrontée à 20 % , le Japon à 24 % , Taïwan à 32 % , et de nombreux autres pays sont frappés par des taux élevés de l'ordre de 15 à 30 % et plus. Certains pays en développement sont particulièrement touchés : par exemple, le Vietnam est confronté à un tarif de 46 % sur ses exportations vers les États-Unis, bien au-dessus de ce qu'impliquerait normalement la « réciprocité ». En fait, les économistes notent que ces tarifs ne pas réellement les tarifs étrangers (qui ont tendance à être beaucoup plus bas) ; ils sont calibrés sur les déficits américains, et non sur les droits d'importation des autres pays. Au total, environ 1 000 milliards de dollars d’importations américaines sont désormais soumises à des taxes considérablement plus élevées, ce qui constitue une barrière protectionniste sans précédent.
-
Produits exclus : L’administration a exclu certaines importations des nouveaux droits de douane, pour des raisons de sécurité nationale ou pratiques. Selon la fiche d’information de la Maison-Blanche, les biens déjà soumis à des droits de douane distincts (tels que l’acier et l’aluminium, ainsi que les automobiles et les pièces détachées automobiles en vertu des précédentes mesures de l’article 232) sont exclus des droits de douane « réciproques ». De même, les matières premières essentielles que les États-Unis ne peuvent pas s’approvisionner sur le marché intérieur – produits énergétiques (pétrole, gaz) et minéraux spécifiques (par exemple, les terres rares) – sont exemptées. Les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs et les fournitures médicales sont notamment exclus afin d’éviter de mettre en péril les secteurs de la santé et des technologies. Ces exclusions reconnaissent que certaines chaînes d’approvisionnement sont trop vitales ou irremplaçables pour être perturbées immédiatement. Malgré cela, le taux tarifaire moyen américain va exploser, passant d’environ 2,5 % l’an dernier à environ 22 % aujourd’hui, pondéré par la valeur des importations – un niveau de protection jamais observé depuis le début des années 1930.
-
Mesures tarifaires connexes : L’annonce du 3 avril fait suite à plusieurs autres mesures tarifaires prises plus tôt en 2025, qui, ensemble, forment un mur commercial complet. En mars 2025, l’administration a imposé des droits de douane de 25 % sur l’acier et l’aluminium importés (réitérant et élargissant les droits de douane sur l’acier de 2018) et a annoncé des droits de douane de 25 % sur les automobiles et les pièces automobiles clés étrangères (en vigueur début avril). Un droit de douane distinct de 20 % sur les produits chinois avait déjà été mis en place le 4 mars 2025 en guise de sanction pour le rôle présumé de la Chine dans le trafic de fentanyl, et ces 20 % s’ajoutaient aux nouveaux 34 % annoncés en avril. De même, la plupart des importations en provenance du Canada et du Mexique sont soumises à des droits de douane de 25 %, sauf si elles respectent strictement les exigences des « règles d’origine » de l’AEUMC – une mesure liée aux exigences américaines en matière de politique migratoire et de drogue. En résumé, en avril 2025, les États-Unis imposent des droits de douane sur un large éventail de biens : des matières premières comme l’acier aux produits de consommation finis, auprès de leurs adversaires comme de leurs alliés. L’administration Trump a même évoqué l’imposition de futurs tarifs douaniers sur des secteurs spécifiques tels que le bois et les produits pharmaceutiques (potentiellement 25 % sur les médicaments importés) dans le cadre de sa stratégie visant à forcer le rapatriement de la chaîne d’approvisionnement.
Secteurs et pays concernés : Étant donné que les droits de douane s'appliquent à la quasi- totalité des importations, tous les grands secteurs sont touchés , directement ou indirectement. Cependant, certains secteurs se démarquent :
-
Industrie manufacturière et industrie lourde : Les biens industriels sont soumis au taux de référence de 10 % à l’échelle mondiale, avec des taux plus élevés pour les fabricants de pays comme l’Allemagne (via les droits de douane de l’UE), le Japon, la Corée du Sud, etc. Les biens d’équipement et les machines importés seront plus coûteux. En particulier, les automobiles et les pièces détachées importées sont soumises à un lourd droit de 25 % (imposé séparément), ce qui frappe durement les constructeurs automobiles européens et japonais. L’acier et l’aluminium restent soumis à un droit de douane de 25 %, issu de mesures antérieures. Ces droits visent à protéger les producteurs de métaux et les constructeurs automobiles américains et à encourager ces industries à produire localement.
-
Biens de consommation et vente au détail : Des catégories comme l'électronique, les vêtements, les appareils électroménagers, les meubles et les jouets, dont une grande partie est importée ( Trump annonce de nouveaux droits de douane draconiens pour promouvoir l'industrie manufacturière américaine, au risque d'inflation et de guerres commerciales | AP News ), verront leurs prix augmenter en raison des droits de douane (par exemple, de nombreux appareils électroniques en provenance de Chine ou du Mexique sont désormais soumis à des droits de douane de 10 à 34 % ). Les produits de consommation courante, des téléphones portables aux jouets pour enfants en passant par les vêtements , sont explicitement dans le collimateur des nouveaux droits de douane. Les principaux détaillants américains ont averti que le coût de ces taxes serait inévitablement répercuté sur les consommateurs si elles se maintenaient.
-
Agriculture et alimentation : Bien que les matières premières agricoles ne soient pas exclues, les États-Unis importent relativement moins de produits alimentaires de base. Cependant, certaines importations alimentaires (fruits, légumes hors saison, café, cacao, fruits de mer, etc.) entraîneront un surcoût d'au moins 10 %. Parallèlement, les agriculteurs américains sont fortement exposés à l'exportation : des partenaires clés comme la Chine, le Mexique et le Canada ripostent en imposant des droits de douane sur les exportations agricoles américaines (par exemple, la Chine a imposé jusqu'à 15 % de droits de douane sur le soja, le porc, le bœuf et la volaille américains en réponse). Ainsi, le secteur agricole est indirectement touché par les pertes de ventes à l'exportation et les excédents.
-
Composants technologiques et industriels : De nombreux produits ou composants de haute technologie importés d’Asie seront soumis à des droits de douane (bien que certains semi-conducteurs critiques en soient exemptés). Par exemple, les équipements de réseau, l’électronique grand public et le matériel informatique – souvent fabriqués en Chine, à Taïwan ou au Vietnam – sont désormais soumis à des taxes d’importation importantes. La chaîne d’approvisionnement des technologies grand public est fortement mondialisée : comme l’a souligné le PDG de Best Buy, la Chine et le Mexique sont les deux principaux fournisseurs de produits électroniques vendus. Les droits de douane sur ces sources perturberont les stocks et augmenteront les coûts pour les détaillants technologiques. De plus, la Chine a riposté en restreignant les exportations de terres rares (essentielles à la fabrication de haute technologie), ce qui pourrait peser sur les entreprises américaines des secteurs de la technologie et de la défense qui dépendent de ces intrants.
-
Énergie et ressources : Le pétrole brut, le gaz naturel et certains minéraux essentiels ont été exemptés par les États-Unis (reconnaissant la nécessité de ces importations). Cependant, d'un point de vue géopolitique, le secteur énergétique n'est pas épargné : début 2025, la Chine a imposé un nouveau droit de douane de 15 % sur les exportations américaines de charbon et de GNL, et de 10 % sur le pétrole brut américain . Cette mesure de rétorsion chinoise portera préjudice aux exportateurs d'énergie américains. De plus, l'incertitude entourant l'approvisionnement pourrait décourager les investissements énergétiques transfrontaliers.
En résumé, les droits de douane d'avril 2025 marquent un virage protectionniste radical dans la politique commerciale américaine. De par leur conception, ils touchent l'ensemble des relations commerciales et des secteurs d'activité majeurs . Les sections suivantes analysent les impacts attendus de ces mesures jusqu'en 2027 sur l'économie, les industries et le commerce mondial.
Effets macroéconomiques (PIB, inflation, taux d'intérêt)
Le large consensus parmi les économistes est que ces droits de douane freineront la croissance économique et stimuleront l'inflation aux États-Unis et dans le monde. Selon Trump, ces droits de douane généreront des centaines de milliards de dollars de recettes et relanceront la production nationale. Cependant, la plupart des experts avertissent que tout gain de recettes à court terme risque d'être contrebalancé par la hausse des coûts, la réduction des volumes d'échanges et les mesures de rétorsion.
Impact sur la croissance du PIB : Tous les pays subiront une perte de croissance du PIB réel entre 2025 et 2027 en raison de la guerre tarifaire. En taxant de fait les importations (et en provoquant des représailles contre les exportations), les droits de douane réduisent l’activité commerciale globale et l’efficacité. Comme l’a résumé un économiste : « Toutes les économies concernées par les droits de douane subiront une perte de leur PIB réel » et une hausse des prix à la consommation. L’économie américaine, profondément intégrée aux chaînes d’approvisionnement mondiales, pourrait ralentir considérablement : les consommateurs achèteront moins de biens si les prix flambent, et les exportateurs vendront moins si les marchés étrangers se ferment. Les principales institutions de prévision ont revu à la baisse leurs projections de croissance ; par exemple, les analystes de JPMorgan ont relevé à 60 % la probabilité d’une récession américaine en 2025-2026, citant le choc tarifaire comme principale raison (contre 30 % dans le scénario de base avant ces mesures). Fitch Ratings a également averti que si le tarif moyen américain grimpait réellement à environ 22 %, ce serait un choc si grave que « l’on pourrait jeter la plupart des prévisions par la fenêtre » et que de nombreux pays finiraient probablement en récession dans le cadre d’un régime tarifaire prolongé.
À court terme (les 6 à 12 prochains mois), l'imposition soudaine de droits de douane provoque une forte contraction des flux commerciaux et un choc sur la confiance des entreprises. Les importateurs américains s'efforcent de s'adapter, ce qui peut entraîner des pénuries temporaires d'approvisionnement ou des achats précipités (certaines entreprises ont concentré leurs stocks avant l'entrée en vigueur des droits de douane, ce qui a dopé les importations au premier trimestre 2025, mais a entraîné une baisse par la suite). Les exportateurs, en particulier les agriculteurs et les fabricants, constatent déjà des annulations de commandes, les acheteurs étrangers anticipant de nouveaux droits de douane. Cette perturbation pourrait entraîner un bref ralentissement mi-2025 , voire une contraction économique à certains trimestres. En 2026-2027, si les droits de douane persistent, les chaînes d'approvisionnement mondiales se réorienteront et une partie de la production pourrait être délocalisée , mais les coûts de transition maintiendront probablement la croissance en dessous de la tendance d'avant les droits de douane. Le Fonds monétaire international a averti qu’une guerre commerciale prolongée d’une telle ampleur pourrait soustraire plusieurs points de pourcentage du PIB mondial sur quelques années, comme cela s’est produit lors des précédents épisodes de protectionnisme mondial (bien que les chiffres exacts attendent une analyse actualisée du FMI à la lumière de ces nouvelles politiques).
Historiquement, la comparaison a été faite avec la loi Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 , qui a augmenté les droits de douane américains sur des milliers de marchandises et est largement considérée comme ayant aggravé la Grande Dépression. Les analystes notent que les niveaux tarifaires actuels approchent des niveaux jamais vus depuis Smoot-Hawley . Tout comme les droits de douane des années 1930 ont provoqué un effondrement du commerce international, les mesures actuelles risquent de s'auto-infliger la même blessure. Le Cato Institute, un organisme libertarien, a averti que les nouveaux droits de douane risquaient de déclencher une guerre commerciale et d'aggraver la Grande Dépression**, dans un parallèle historique. Bien que le contexte économique actuel soit différent (le commerce représente une part plus faible du PIB américain que dans certains pays et la politique monétaire est plus réactive), l'impact – un impact négatif sur la production – devrait être le même, même s'il n'est pas aussi catastrophique que dans les années 1930.
Inflation et prix à la consommation : Les droits de douane agissent comme une taxe sur les biens importés, et les importateurs répercutent souvent les coûts sur les consommateurs. Par conséquent, l’inflation est susceptible d’augmenter à court terme . Les consommateurs américains verront les prix augmenter sur un large éventail de produits, tels que l’alimentation, les vêtements, les jouets et l’électronique, qui deviendront plus chers car beaucoup proviennent de Chine, du Vietnam, du Mexique et d’autres pays touchés par les droits de douane. Par exemple, des groupes industriels ont estimé que le prix des jouets pourrait augmenter jusqu’à 50 % en raison des droits de douane combinés de 34 à 46 % sur les jouets en provenance de Chine et du Vietnam, qui dominent la chaîne d’approvisionnement du jouet (ce chiffre a été cité par les fabricants de jouets début avril 2025 ( Ce qu’il faut savoir sur les droits de douane de Trump et leur impact sur les entreprises et les consommateurs | AP News )). De même, les appareils électroniques grand public populaires comme les smartphones et les ordinateurs portables, dont beaucoup sont assemblés en Chine, pourraient connaître des augmentations de prix à deux chiffres.
Les principaux distributeurs américains confirment que des hausses de prix sont attendues . Corie Barry, PDG de Best Buy, a indiqué que leurs fournisseurs, toutes catégories confondues, « répercuteront probablement une partie des coûts des droits de douane sur les détaillants, ce qui rendrait très probable une hausse des prix pour les consommateurs américains ». La direction de Target a également averti que les droits de douane exercent une pression significative sur les coûts et les marges, ce qui conduit à terme à une hausse des prix en rayon. Globalement, les économistes prévoient que l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pourrait être supérieure de 1 à 3 points de pourcentage en 2025-2026 à ce qu'elle aurait été sans les droits de douane, en supposant que les entreprises répercutent une grande partie des coûts. Cela survient alors que l'inflation était en baisse ; les droits de douane pourraient donc compromettre les efforts de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation . Ironiquement, le président Trump a fait campagne sur la réduction de l'inflation, mais en augmentant largement les taxes à l'importation – un point que même certains sénateurs républicains des États agricoles et frontaliers ont soulevé dans leur opposition.
Cela dit, il existe certains moyens de moduler l'inflation après le choc initial. Si la demande des consommateurs faiblit en raison de la hausse des prix et de l'incertitude, les détaillants pourraient ne pas être en mesure de répercuter 100 % des coûts et pourraient accepter des marges plus faibles ou réduire leurs coûts ailleurs. De plus, un dollar fort (si les investisseurs mondiaux recherchent la sécurité dans les actifs américains pendant la crise) pourrait compenser partiellement les hausses des prix à l'importation. En effet, immédiatement après l'annonce des droits de douane, les marchés financiers ont signalé des attentes de ralentissement de la croissance , ce qui a exercé une pression à la baisse sur les taux d'intérêt (par exemple, les rendements des bons du Trésor américain ont chuté, contribuant à une baisse des taux hypothécaires). Des taux d'intérêt plus bas peuvent, au fil du temps, freiner l'inflation en refroidissant la demande. Cependant, à court terme (les 6 à 12 prochains mois), l' effet net est probablement stagflationniste : une inflation plus élevée combinée à un ralentissement de la croissance, à mesure que l'économie s'adapte au nouveau régime commercial.
**Politique monétaire et taux d'intérêt : D'une part, l'inflation induite par les tarifs douaniers pourrait nécessiter un resserrement de la politique monétaire (taux d'intérêt plus élevés) afin de contenir la croissance des prix. D'autre part, le risque de récession et la volatilité des marchés financiers plaideraient en faveur d'un assouplissement de la politique. Dans un premier temps, la Fed a indiqué qu'elle suivrait la situation de près ; de nombreux analystes s'attendent à ce qu'elle adopte une approche attentiste jusqu'à la mi-2025, évaluant si le ralentissement de la croissance ou la hausse de l'inflation constitue la tendance dominante. Si des signes indiquent un ralentissement marqué (par exemple, une hausse du chômage ou une baisse de la production), la Fed pourrait même baisser ses taux malgré la hausse des prix à l'importation. De fait, les indices boursiers américains ont fortement chuté pendant plusieurs jours consécutifs ; le Dow Jones a chuté de plus de 5 % sur les deux séances de bourse suivant les mesures de rétorsion de la Chine, reflétant les craintes de récession. La baisse des rendements obligataires a déjà contribué à réduire les taux hypothécaires et autres taux d'intérêt à long terme, même sans intervention de la Fed.
Sur la période 2025-2027, les taux d'intérêt seront donc déterminés par l'effet qui prévaudra : une inflation soutenue due aux droits de douane ou un ralentissement économique durable. Si la guerre commerciale se poursuit malgré l'application de droits de douane complets, de nombreux économistes prédisent que la Fed pourrait opter pour un assouplissement monétaire fin 2025 afin de stimuler la croissance, une fois que le choc initial sur les prix aura été absorbé et que la principale menace sera le chômage. D'ici 2026 ou 2027, si une récession s'installe (ce qui est une possibilité réelle dans un scénario d'escalade de la guerre commerciale), les taux d'intérêt pourraient être considérablement plus bas qu'aujourd'hui, la Fed (et les autres banques centrales mondiales) s'efforçant de relancer la demande. À l'inverse, si l'économie fait preuve d'une résilience inattendue et que l'inflation reste élevée, la Fed pourrait être contrainte d'adopter une position plus restrictive, risquant ainsi un scénario de stagflation. En bref, les droits de douane ajoutent une incertitude significative aux perspectives de politique monétaire. La seule certitude est que les décideurs politiques naviguent désormais en territoire inconnu – des niveaux de droits de douane américains jamais vus depuis près d’un siècle – ce qui rend les résultats macroéconomiques hautement imprévisibles.
Impacts sectoriels spécifiques (fabrication, agriculture, technologie, énergie)
Le choc tarifaire se répercutera de manière inégale sur les différents secteurs, créant des gagnants, des perdants et des coûts d'ajustement généralisés . Certains secteurs protégés pourraient bénéficier d'un coup de pouce temporaire, tandis que d'autres subiraient des coûts plus élevés.
Fabrication et industrie
(Fiche d'information : Le président Donald J. Trump déclare l'état d'urgence nationale pour renforcer notre compétitivité, protéger notre souveraineté et renforcer notre sécurité nationale et économique – La Maison Blanche)
L'industrie manufacturière est au cœur des droits de douane imposés par Trump. Le président affirme que ces taxes à l'importation relanceront les usines américaines et permettront de recréer des emplois perdus à cause des délocalisations. En effet, des secteurs comme l'acier, l'aluminium, les machines et les pièces automobiles, longtemps concurrencés par des importations moins chères, sont désormais protégés par d'importants droits de douane sur leurs concurrents étrangers. En théorie, cela devrait donner aux producteurs américains un avantage sur le marché intérieur. Par exemple, les machines ou outils importés d'Europe sont désormais soumis à un droit de douane de 20 %, ce qui rend les équipements fabriqués aux États-Unis relativement moins chers pour les acheteurs américains. Les sidérurgistes ont déjà bénéficié du droit de douane de 25 % sur l'acier : les prix de l'acier national ont bondi par anticipation, ce qui pourrait permettre aux aciéries américaines d'augmenter leur production et de réembaucher certains travailleurs (comme cela s'est produit peu après l'imposition des droits de douane de 2018). L'industrie automobile pourrait également subir des effets contrastés : les importations de voitures de marques étrangères sont plus chères avec le nouveau droit de douane de 25 %, ce qui pourrait inciter certains consommateurs américains à opter pour une voiture assemblée aux États-Unis. À court terme, les trois grands constructeurs automobiles américains (GM, Ford, Stellantis) pourraient gagner des parts de marché si les prix des véhicules importés flambent. Certains constructeurs européens et asiatiques envisageraient de délocaliser davantage leur production aux États-Unis pour éviter les droits de douane, ce qui pourrait impliquer de nouveaux investissements industriels aux États-Unis au cours des deux prochaines années (par exemple, Volkswagen et Toyota agrandissent leurs chaînes de montage aux États-Unis).
Cependant, tout gain pour les fabricants nationaux s'accompagne de coûts et de risques importants . Premièrement, de nombreux fabricants américains dépendent de composants et de matières premières importés. Le tarif général de 10 % sur les intrants tels que l'électronique, les métaux, les plastiques et les produits chimiques augmente le coût de production aux États-Unis. Par exemple, une usine d'électroménager américaine pourrait encore avoir besoin d'importer des pièces spéciales de Chine ; ces pièces coûtent désormais 34 % de plus, ce qui érode la compétitivité du produit final. Les chaînes d'approvisionnement sont profondément imbriquées , un point mis en évidence par l'industrie automobile, où les pièces traversent plusieurs fois les frontières de l'ALENA/AEUMC. Les nouveaux tarifs perturbent ces chaînes d'approvisionnement : les pièces automobiles en provenance de Chine sont soumises à des tarifs, et les pièces circulant entre les États-Unis, le Mexique et le Canada sont soumises à des tarifs si elles ne respectent pas les règles d'origine strictes de l'AEUMC , ce qui peut également augmenter les coûts d'assemblage aux États-Unis. En conséquence, certains constructeurs automobiles mettent en garde contre une hausse des coûts de production et des licenciements potentiels en cas de baisse des ventes. Selon un rapport sectoriel d'avril 2025, les grands constructeurs automobiles comme BMW et Toyota, qui importent de nombreux modèles et composants finis, ont commencé à prévoir des hausses de prix, voire à interrompre certaines chaînes de production en raison de la baisse attendue des ventes. Cela indique que, si Détroit pourrait en bénéficier, le secteur automobile dans son ensemble (concessionnaires et fournisseurs compris) pourrait subir des pertes d'emplois si les ventes globales de voitures chutent en raison de la hausse des prix.
Deuxièmement, les exportateurs manufacturiers américains sont vulnérables aux représailles. Des pays comme la Chine, le Canada et l'UE ripostent en imposant des droits de douane sur les produits industriels américains (entre autres). Par exemple, le Canada a annoncé qu'il alignerait les droits de douane américains sur les véhicules automobiles avec un droit de douane de 25 % sur les véhicules fabriqués aux États-Unis . Cela signifie que les exportations automobiles américaines (environ 1 million de véhicules par an, dont beaucoup vers le Canada) en pâtiront, ce qui portera préjudice aux usines automobiles américaines qui construisent pour l'exportation. La liste des mesures de rétorsion de la Chine comprend également des produits manufacturés tels que des pièces d'avion, des machines et des produits chimiques. Si une usine américaine perd l'accès aux acheteurs étrangers en raison de droits de douane de rétorsion, elle pourrait être contrainte de réduire sa production. Par exemple, Boeing (un constructeur aérospatial américain) est désormais confronté à l'incertitude en Chine – auparavant son plus grand marché unique – car la Chine devrait réorienter ses achats d'avions vers Airbus en Europe pour sanctionner la position commerciale américaine. Ainsi, des secteurs comme l'aérospatiale et la machinerie lourde pourraient perdre d'importantes ventes internationales .
En résumé, pour le secteur manufacturier, les droits de douane offrent un soulagement de la concurrence à l'importation sur le marché intérieur (un avantage pour certaines entreprises), mais augmentent les coûts des intrants et provoquent des représailles étrangères , ce qui est négatif pour d'autres. Entre 2025 et 2027, nous pourrions assister à la création de certains emplois manufacturiers dans des niches protégées (aciéries, peut-être de nouvelles usines d'assemblage), mais aussi à des pertes d'emplois dans des secteurs qui deviennent moins compétitifs ou qui font face à une baisse des exportations. Même aux États-Unis, la hausse des prix des produits manufacturés pourrait freiner la demande ; par exemple, les entreprises de construction pourraient acheter moins de machines si les prix des équipements flambent, réduisant ainsi les commandes des fabricants de machines. Un indicateur précoce : l' indice PMI (Purchasing Managers' Index) du secteur manufacturier a fortement chuté en avril et mai 2025, signalant une contraction, les nouvelles commandes (en particulier celles à l'exportation) se tarissant. Cela suggère qu'en termes nets, l'activité manufacturière pourrait décliner à court terme malgré la protection, en raison du ralentissement économique global.
Agriculture et industrie alimentaire
Le secteur agricole est l'un des plus directement exposés aux retombées d'une guerre commerciale. Si les États-Unis importent certains produits alimentaires, ils sont un exportateur majeur de matières premières agricoles, et ces exportations sont la cible de représailles. Dans la journée qui a suivi l'annonce de Trump, la Chine, le Mexique et le Canada, les trois plus gros acheteurs de produits agricoles américains, ont tous annoncé des droits de douane en représailles sur l'agriculture américaine . La Chine, par exemple, a imposé des droits de douane allant jusqu'à 15 % sur un large éventail d'exportations agricoles américaines, notamment le soja, le maïs, le bœuf, le porc, la volaille, les fruits et les noix. Ces produits sont des piliers de l'économie agricole américaine (la Chine a acheté pour plus de 20 milliards de dollars par an de soja américain rien que ces dernières années). Les nouveaux droits de douane chinois rendront les céréales et les viandes américaines plus chères en Chine, ce qui incitera probablement les importateurs chinois à se tourner vers des fournisseurs au Brésil, en Argentine, au Canada ou ailleurs. De même, le Mexique a indiqué qu'il prendrait des mesures de représailles sur l'agriculture américaine (bien qu'au moment de l'annonce, le Mexique ait retardé la spécification de la liste, laissant entrevoir l'espoir de négociations). Le Canada a déjà imposé des droits de douane sur certains produits alimentaires américains (en 2025, le Canada a imposé un droit de douane de 25 % sur environ 30 milliards de dollars canadiens de marchandises américaines, y compris certains produits agricoles comme les produits laitiers et les aliments transformés américains).
Pour les agriculteurs américains, il s'agit d'un douloureux souvenir de la guerre commerciale de 2018-2019, mais à plus grande échelle. Les revenus agricoles devraient baisser en raison du rétrécissement des marchés d'exportation et de la chute des prix intérieurs des récoltes excédentaires. Les stocks de soja, par exemple, s'accumulent à nouveau, la Chine annulant des commandes, ce qui fait baisser les prix du soja et nuit aux revenus agricoles. De plus, tout équipement agricole ou engrais importé coûte désormais plus cher en raison des droits de douane, ce qui augmente les coûts d'exploitation des agriculteurs. L'effet net est une compression des marges bénéficiaires agricoles et potentiellement des licenciements dans les zones rurales . Le secteur agricole s'est exprimé haut et fort : une coalition d'associations américaines du secteur agroalimentaire a qualifié les droits de douane de « déstabilisateurs » et a averti qu'ils « risquaient de compromettre les objectifs de soutien à la croissance nationale » . Même les législateurs républicains de l'Iowa, du Kansas et d'autres États fortement tributaires de l'agriculture font pression sur l'administration pour qu'elle accorde des allègements ou des exemptions, soulignant que les faillites agricoles pourraient augmenter si la guerre commerciale persiste.
Français Les consommateurs ressentiront certains effets dans l'épicerie, bien que les États-Unis soient largement autosuffisants en produits de base. Les droits de douane sur les importations de denrées alimentaires que l'Amérique ne cultive pas (produits tropicaux comme le café, le cacao, les épices, certains fruits) signifient des prix légèrement plus élevés pour ces produits . Par exemple, le chocolat pourrait devenir plus cher parce que le cacao de Côte d'Ivoire est désormais soumis à un droit de douane américain de 21 % , alors que les États-Unis ne peuvent pas produire de cacao sur leur territoire en quantité significative. (La Côte d'Ivoire produit environ 40 % du cacao mondial et les États-Unis doivent importer la quasi-totalité de leurs besoins en cacao.) Cela illustre un point plus large : pour certains produits agricoles qui doivent être importés en raison du climat (café, cacao, bananes, etc.), les droits de douane augmentent simplement les coûts sans aucun avantage de délocalisation de la production aux États-Unis – il est impossible de cultiver du café dans l'Ohio ou d'élever des crevettes tropicales dans l'Iowa. Le Peterson Institute for International Economics (PIIE) a souligné cette limitation inhérente, notant qu'il est « littéralement impossible » de relocaliser la production de certains aliments comme le cacao et le café ; Les droits de douane sur ces produits « ne feront qu'imposer des coûts aux pays déjà pauvres » qui les exportent, sans aucun avantage pour l'industrie américaine. Dans ce cas, les consommateurs américains paient plus cher et les agriculteurs des pays en développement gagnent moins – une situation où tout le monde est perdant.
Perspectives pour 2025-2027 : Si les droits de douane sont maintenus, le secteur agricole devrait se consolider et rechercher de nouveaux marchés. Le gouvernement américain pourrait intervenir en accordant des subventions ou des aides financières aux agriculteurs (comme il l’a fait en 2018-2019) pour compenser les pertes. Certains agriculteurs pourraient réduire leurs cultures affectées par les droits de douane et se tourner vers d’autres (par exemple, une réduction des surfaces consacrées au soja en 2026 si la demande chinoise reste faible). Les courants d’échanges pourraient évoluer : davantage de soja et de maïs américains pourraient être destinés à l’Europe ou à l’Asie du Sud-Est si la Chine reste fermée, mais l’ajustement des flux commerciaux prend du temps et implique souvent des remises. D’ici 2027, nous pourrions également assister à des changements structurels : des pays comme la Chine investissent massivement dans des fournisseurs alternatifs (le Brésil défrichant davantage de terres pour la production de soja, etc.), ce qui signifie que même si les droits de douane sont supprimés ultérieurement, les agriculteurs américains pourraient avoir du mal à regagner facilement leurs parts de marché. Dans le pire des cas, une guerre commerciale prolongée pourrait modifier durablement le commerce agricole mondial, au détriment des exportateurs américains. Au niveau national, les consommateurs pourraient ne pas remarquer de pénuries majeures, mais ils pourraient constater une baisse de la prospérité des industries agricoles exportatrices, ce qui pourrait impacter les ventes d'équipements agricoles, l'emploi rural et les industries agroalimentaires liées aux exportations (comme la trituration du soja pour la production de tourteaux et d'huile). En bref, l'agriculture risque d'être fortement perdante dans cette bataille tarifaire, à court et à long terme, si les acheteurs étrangers adoptent de nouvelles habitudes.
Technologie et électronique
Le secteur technologique est confronté à une combinaison complexe d'effets. De nombreux produits technologiques sont importés (et donc frappés par les droits de douane américains), et les entreprises technologiques américaines sont également présentes sur les marchés mondiaux (et donc exposées à des représailles étrangères).
Du côté des importations, l'électronique grand public et le matériel informatique figurent parmi les principales importations en provenance de Chine et d'Asie. Des articles comme les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes, les équipements réseau, les téléviseurs, etc., que les consommateurs et les entreprises américains achètent en grandes quantités, sont désormais soumis à des droits de douane d'au moins 10 %, voire plus dans de nombreux cas (34 % en provenance de Chine, 24 % au Japon ou en Malaisie, 46 % au Vietnam, etc.). Cela entraînera probablement une augmentation des coûts pour des entreprises comme Apple, Dell, HP et de nombreuses autres qui importent des appareils finis ou des composants. Nombre d'entre elles avaient tenté de diversifier leur production hors de Chine lors des précédentes tensions commerciales – par exemple en délocalisant une partie de l'assemblage au Vietnam ou en Inde – mais les nouveaux droits de douane imposés par Trump n'épargnent quasiment aucun autre pays (le droit de douane de 46 % appliqué au Vietnam en est un parfait exemple). Certaines entreprises pourraient tenter d'invoquer la faille de l'AEUMC en faisant transiter l'assemblage par le Mexique ou le Canada (qui restent exempts de droits de douane pour les produits éligibles), mais l'administration prévoit de sévir contre les contenus non nord-américains, même dans ces pays. À court terme, il faut s'attendre à des perturbations de l'approvisionnement et à des hausses de coûts dans la chaîne d'approvisionnement technologique. Les grands distributeurs stockent des produits électroniques pour retarder les hausses de prix, mais ces stocks ne dureront pas éternellement. D'ici les fêtes de fin d'année 2025, les gadgets en rayon pourraient afficher des prix sensiblement plus élevés. Les entreprises technologiques devront peut-être choisir entre absorber une partie des coûts (affectant ainsi leurs marges bénéficiaires) ou les répercuter entièrement sur les consommateurs. L'avertissement de Best Buy concernant des hausses de prix importantes suggère qu'une partie au moins des coûts atteindra les consommateurs finaux.
Au-delà des appareils grand public, les technologies et composants industriels sont également impactés. Par exemple, les semi-conducteurs – dont beaucoup sont fabriqués à Taïwan, en Corée du Sud ou en Chine – sont des intrants essentiels pour les industries américaines. La Maison Blanche a explicitement , probablement pour éviter de paralyser la production électronique américaine. Cependant, d'autres composants, comme les circuits imprimés, les batteries, les composants optiques, etc., pourraient ne pas être tous exemptés. Toute pénurie ou augmentation des coûts de ces composants peut ralentir la production de tous types de produits, des voitures aux équipements de télécommunications. Si les droits de douane persistent, nous pourrions assister à une accélération de la tendance à la localisation des chaînes d'approvisionnement technologiques : une plus grande partie de l'assemblage de puces et de la fabrication électronique pourrait être délocalisée aux États-Unis ou dans des pays alliés non soumis à des droits de douane. De fait, l'administration Biden (lors du mandat précédent) avait déjà commencé à encourager les usines nationales de semi-conducteurs ; les droits de douane de Trump accentuent la pression sur les entreprises technologiques pour qu'elles localisent ou diversifient leur production.
Du côté des exportations, les entreprises technologiques américaines pourraient subir des réactions négatives de la part de l'étranger sur des marchés clés. Jusqu'à présent, les représailles chinoises ont pris des formes visant indirectement la technologie et l'industrie américaines : Pékin a annoncé l'imposition de contrôles plus stricts à l'exportation sur les minéraux de terres rares (comme le samarium et le gadolinium), essentiels à la fabrication de produits de haute technologie tels que les puces électroniques, les batteries de véhicules électriques et les composants aérospatiaux. Cette mesure constitue une riposte stratégique, la Chine dominant l'approvisionnement mondial en terres rares. Elle pourrait paralyser les entreprises technologiques et de défense américaines si elles ne peuvent pas se procurer ces matériaux, ou les contraindre à payer des prix plus élevés auprès de sources non chinoises. Par ailleurs, la Chine a allongé sa liste d'entreprises américaines sous sanctions ou restrictions : 27 entreprises américaines supplémentaires ont été ajoutées à ses listes noires commerciales , dont certaines dans le secteur technologique. Notamment, une entreprise américaine de technologie de défense et une entreprise de logistique figuraient parmi celles interdites d'accès à certaines activités en Chine, et la Chine a lancé des enquêtes sur des entreprises américaines comme DuPont en Chine pour pratiques antitrust et dumping. Ces actions indiquent que les entreprises technologiques et industrielles américaines opérant en Chine pourraient être confrontées à un harcèlement réglementaire ou à des boycotts de la part des consommateurs. Par exemple, Apple et Tesla – des entreprises américaines de premier plan en Chine – n'ont pas encore été directement visées, mais les réseaux sociaux chinois regorgent d'appels nationalistes à « acheter chinois » et à éviter les marques américaines après l'annonce des droits de douane. Si ce sentiment se renforce, les entreprises technologiques américaines pourraient voir leurs ventes diminuer en Chine, premier marché mondial des smartphones et des véhicules électriques.
Implications à long terme pour la technologie : Sur deux ans, le secteur technologique pourrait connaître une réorientation stratégique . Les entreprises pourraient investir davantage dans la production dans les régions exemptées de droits de douane (peut-être en agrandissant leurs usines aux États-Unis, bien que cela prenne du temps et coûte plus cher) ou se lancer davantage dans les logiciels et les services afin de réduire leur dépendance aux bénéfices du matériel. Quelques effets secondaires positifs : des producteurs nationaux de composants auparavant exclusivement chinois pourraient émerger si l'occasion se présente (par exemple, une start-up américaine pourrait se lancer dans la fabrication nationale d'un type de composant électronique pour combler le manque, aidée par une marge de prix de 34 % due aux droits de douane). Le gouvernement américain est également susceptible de soutenir les industries technologiques essentielles (par le biais de subventions ou du Defense Production Act) afin d'atténuer les problèmes d'approvisionnement. D'ici 2027, nous pourrions observer une chaîne d'approvisionnement technologique moins centrée sur la Chine, mais aussi moins efficace, ce qui se traduirait par des coûts de base plus élevés et un rythme d'innovation potentiellement plus lent en raison d'une collaboration mondiale réduite. Dans l’intervalle, le choix des consommateurs pourrait se réduire (si certaines marques d’électronique à bas prix d’Asie se retirent du marché américain) et l’innovation pourrait en souffrir, car les entreprises dépensent des ressources dans la navigation tarifaire plutôt que dans la R&D.
Énergie et matières premières
Le secteur de l'énergie a été partiellement épargné intentionnellement, mais il reste affecté par les tensions commerciales plus larges et les mesures de rétorsion spécifiques. Les États-Unis ont délibérément exclu le pétrole brut, le gaz naturel et les minéraux critiques de leurs droits de douane, reconnaissant que leur taxation augmenterait le coût des intrants pour l'industrie et les consommateurs américains (par exemple, une hausse du prix de l'essence) sans stimuler sensiblement la production nationale. Les États-Unis ne peuvent pas encore satisfaire toute leur demande de certains minéraux (comme les terres rares, le cobalt et le lithium) ou de pétrole brut lourd ; ces importations restent donc exemptées de droits de douane afin de garantir l'approvisionnement. De plus, les « lingots » (or, etc.) ont été exemptés, probablement pour éviter de perturber les marchés financiers.
Cependant, les partenaires commerciaux des États-Unis n'ont pas été aussi cléments envers les exportations énergétiques américaines. Les représailles de la Chine sont particulièrement notables dans le secteur de l'énergie : début 2025, elle a imposé des droits de douane de 15 % sur le charbon et le gaz naturel liquéfié (GNL) américains, ainsi que de 10 % sur le pétrole brut américain. Importatrice croissante de GNL, la Chine a été un acheteur important de GNL américain ces dernières années ; ces droits de douane pourraient rendre le GNL américain non compétitif en Chine par rapport au GNL qatari ou australien. De même, l'importation de brut américain par la Chine était symbolique des flux commerciaux énergétiques ; désormais, avec ces droits de douane, les raffineurs chinois pourraient se détourner des cargaisons de pétrole américain. En fait, des rapports en provenance de Pékin suggèrent que les entreprises publiques chinoises ont suspendu la signature de nouveaux contrats à long terme avec les exportateurs américains de GNL et recherchent des alternatives (Russie, Moyen-Orient) pour le carburant. Ce détournement du commerce de l’énergie peut avoir un impact sur les entreprises énergétiques américaines : les exportateurs de GNL pourraient devoir trouver d’autres acheteurs (éventuellement en Europe ou au Japon, bien qu’avec des bénéfices moindres si les prix sont affectés), et les producteurs de pétrole américains pourraient voir un marché mondial plus étroit, ce qui pourrait légèrement faire baisser les prix du pétrole aux États-Unis (une bonne chose pour les conducteurs, mais pas pour l’industrie pétrolière).
Une autre dimension géopolitique émerge : les minéraux critiques . Bien que les États-Unis les aient exemptés, la Chine utilise son contrôle sur certains minéraux comme une arme. Nous avons évoqué plus haut les contrôles chinois à l'exportation des terres rares. Ces éléments sont essentiels aux technologies énergétiques (éoliennes, moteurs de véhicules électriques) et à l'électronique. De plus, certains indices laissent penser que la Chine pourrait restreindre les exportations d'autres matériaux (comme le lithium ou le graphite pour les batteries de véhicules électriques) si les tensions s'aggravent. De telles mesures feraient grimper les prix mondiaux de ces intrants et compliqueraient la croissance du secteur des énergies propres (ce qui pourrait ralentir les efforts américains dans les véhicules électriques et les technologies renouvelables, compromettant paradoxalement certains objectifs de production américains dans ces secteurs).
Le marché du pétrole et du gaz dans son ensemble pourrait également subir des effets indirects. Si le commerce mondial ralentit et que les économies basculent vers la récession, la demande de pétrole pourrait chuter, entraînant une baisse des prix du pétrole dans le monde entier. Cela pourrait initialement profiter aux consommateurs américains (essence moins chère à la pompe), mais pénaliserait l'industrie pétrolière américaine, pouvant entraîner une réduction des forages en 2026 en cas de chute des prix. À l'inverse, si les tensions géopolitiques se propagent (par exemple, en cas de réaction imprévisible de l'OPEP ou d'autres acteurs), les marchés de l'énergie pourraient devenir plus volatils.
Des secteurs comme les mines et les produits chimiques pourraient bénéficier d'une certaine protection à l'importation (par exemple, les métaux importés autres que l'acier et l'aluminium sont soumis à des droits de douane de 10 %, ce qui pourrait légèrement aider les mineurs nationaux). Mais ces secteurs sont aussi généralement de gros exportateurs et pourraient être confrontés à des droits de douane étrangers. Par exemple, la Chine a ajouté les produits pétrochimiques et les plastiques à sa liste de droits de douane sur les États-Unis (compte tenu des importantes exportations chimiques américaines), ce qui pourrait nuire aux fabricants de produits chimiques de la côte du Golfe.
En résumé, le secteur de l'énergie et des matières premières est relativement protégé des droits de douane américains directs, mais il est empêtré dans le jeu des représailles mondiales . D'ici 2027, le commerce mondial de l'énergie pourrait se diviser davantage : les exportations américaines de combustibles fossiles seraient davantage orientées vers l'Europe et ses alliés, tandis que la Chine s'approvisionnerait ailleurs. De plus, cette guerre commerciale pourrait, par inadvertance, inciter d'autres pays à réduire leur dépendance à l'égard de l'énergie et des technologies américaines ; par exemple, l'intérêt de la Chine pour les terres rares pourrait accélérer sa propre progression dans la chaîne de valeur (en fabriquant davantage de produits de haute technologie sur son territoire, ce qui lui permettrait de se passer de technologies américaines – même si c'est un problème à plus long terme, au-delà de 2027).
Bilan sectoriel : Si certaines industries américaines pourraient bénéficier d’un répit à court terme face à la concurrence étrangère (par exemple, la sidérurgie et certains appareils électroménagers), la plupart d’entre elles seront confrontées à des coûts plus élevés et à un marché mondial moins favorable . L’interconnexion de la production moderne signifie qu’aucun secteur n’est véritablement isolé . Même les industries protégées pourraient constater que leurs gains sont compensés par des prix d’intrants plus élevés ou des pertes en représailles. Les droits de douane agissent comme un choc de réaffectation : le capital et la main-d’œuvre commenceront à se déplacer vers les industries qui répondent à la demande intérieure, au détriment de celles qui dépendent du commerce. Mais cette réaffectation est inefficace et coûteuse dans l’intervalle. Les deux prochaines années seront probablement une période d’ajustement intense, les industries reconfigurant leurs chaînes d’approvisionnement et leurs stratégies pour faire face au nouveau paysage tarifaire.
Effets sur les chaînes d'approvisionnement et les modèles de commerce international
L'escalade des droits de douane d'avril 2025 risque de bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales et de modifier les modèles commerciaux en gestation depuis des décennies. Les entreprises du monde entier devront réévaluer leurs sources d'approvisionnement en composants et leurs sites de production afin d'atténuer l'impact des droits de douane.
Perturbation des chaînes d'approvisionnement existantes : De nombreuses chaînes d'approvisionnement, notamment dans les secteurs de l'électronique, de l'automobile et de l'habillement, étaient optimisées en supposant de faibles droits de douane et des échanges commerciaux relativement fluides. Soudain, avec l'imposition de droits de douane de 10 à 30 % sur de nombreux mouvements transfrontaliers, la donne a changé. Nous constatons déjà des perturbations immédiates : les marchandises en transit au moment de l'entrée en vigueur des droits de douane sont bloquées au dédouanement, avec des coûts soudainement plus élevés, et les entreprises s'efforcent de réorganiser leurs expéditions . Par exemple, un camion transportant des produits du Mexique vers les États-Unis pourrait désormais être soumis à des droits de douane si les produits ne respectent pas les règles de contenu de l'AEUMC (pour les produits, l'origine locale est simple, mais les aliments transformés contenant des ingrédients américains pourraient être admissibles). Les images de camions chargés de marchandises aux postes frontières soulignent l'intégration des chaînes d'approvisionnement nord-américaines et la nécessité de les adapter. Les biens essentiels continuent de circuler, mais à un coût plus élevé ou avec davantage de formalités administratives pour prouver leur origine.
Les entreprises accéléreront leurs efforts de régionalisation ou de « relocalisation amicale » de leurs chaînes d'approvisionnement . Cela implique de s'approvisionner davantage en intrants sur le marché intérieur ou auprès de pays non soumis à des droits de douane supplémentaires. Le défi, comme indiqué précédemment, réside dans le fait que les États-Unis ont ciblé la quasi-totalité des pays, ce qui limite les possibilités d'approvisionnement totalement exemptées de droits de douane hors d'Amérique du Nord. La zone de sécurité la plus importante se trouve au sein du bloc AEUMC (États-Unis, Mexique, Canada) : les marchandises entièrement conformes aux règles de l'AEUMC (par exemple, les voitures contenant 75 % de contenu nord-américain) peuvent toujours être commercialisées en franchise de droits de douane en Amérique du Nord. Cela incite fortement les entreprises à accroître le contenu nord-américain de leurs produits. On pourrait voir des fabricants tenter de délocaliser davantage la production de composants au Mexique ou au Canada (où les coûts sont inférieurs à ceux des États-Unis, mais où les marchandises peuvent entrer aux États-Unis en franchise de droits si elles sont admissibles). D'ailleurs, le Canada et le Mexique eux-mêmes privilégient cette solution : ils souhaitent que les investissements soient réorientés vers eux plutôt que vers l'Asie. Le gouvernement canadien a déjà pris des mesures, comme l’interdiction de certains produits américains en guise de représailles et l’encouragement de l’approvisionnement local (la province de l’Ontario, par exemple, a cessé d’acheter de l’alcool fabriqué aux États-Unis pour ses magasins d’alcools, afin de promouvoir des alternatives nationales dans le contexte de la lutte contre les tarifs douaniers).
Cependant, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement prend du temps. Entre 2025 et 2027, nous assisterons probablement à des ajustements progressifs plutôt qu'à des restructurations brutales. Par exemple, les fabricants d'électronique pourraient s'approvisionner en composants électroniques à deux sources (certains en provenance de Chine, pays frappé par des droits de douane, d'autres du Mexique) pour se couvrir. Les détaillants pourraient trouver d'autres fournisseurs dans des pays soumis à un droit de douane de base de 10 % au lieu de 34 % (par exemple, s'approvisionner en vêtements au Bangladesh (10 %) plutôt qu'en Chine (34 %)). Il y aura un détournement de trafic : des pays non spécifiquement ciblés pourraient tirer profit de l'approvisionnement de biens provenant auparavant de pays soumis à des droits de douane. Par exemple, le Vietnam et la Chine sont soumis à de lourds droits de douane, de sorte que certains importateurs américains pourraient se tourner vers l'Inde, la Thaïlande ou l'Indonésie pour certains produits (ces pays sont tous soumis à un droit de douane de base de 10 %, voire à des droits supplémentaires, mais généralement inférieurs à ceux de la Chine ; le droit de douane supplémentaire exact de l'Inde n'a pas été annoncé publiquement, mais son excédent commercial avec les États-Unis pourrait entraîner l'imposition de droits de douane supplémentaires). Les entreprises européennes pourraient transférer leurs exportations automobiles vers les États-Unis en passant par leurs usines de Caroline du Sud ou du Mexique afin de contourner les droits de douane. En résumé, il faut s'attendre à une réorganisation des flux commerciaux : la répartition des fournisseurs changera, chacun cherchant à minimiser les coûts des droits de douane.
Volume et structure des échanges mondiaux : Au niveau macroéconomique, ces droits de douane entraîneront probablement une forte contraction du volume des échanges mondiaux en 2025-2026. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a averti que l’effet combiné des droits de douane américains et des mesures de rétorsion pourrait réduire la croissance du commerce mondial de plusieurs points de pourcentage. On pourrait observer un scénario où le commerce mondial croîtrait beaucoup plus lentement que le PIB (voire se contracterait), les pays se repliant sur eux-mêmes. Les États-Unis, eux-mêmes défenseurs historiques du libre-échange, érigent aujourd’hui des barrières commerciales d’une ampleur sans précédent à l’époque moderne. Cela pourrait encourager d’autres pays à approfondir leurs liens commerciaux, à l’exclusion des États-Unis. Par exemple, les membres restants d’accords comme le CPTPP (Partenariat transpacifique sans les États-Unis) ou le RCEP (Partenariat économique régional global en Asie) pourraient intensifier leurs échanges entre eux, tandis que les échanges des États-Unis avec ces pays diminueraient.
Nous pourrions également assister à des blocs commerciaux parallèles . La Chine et peut-être l'UE pourraient chercher à resserrer leurs relations économiques pour contrebalancer le protectionnisme américain, même si l'Europe est également touchée par les droits de douane américains et pourrait s'aligner sur les États-Unis sur certaines questions stratégiques. L'UE, le Royaume-Uni et d'autres alliés pourraient également former un front commun pour négocier avec les États-Unis ou riposter. Jusqu'à présent, la réaction de l'Europe a été éloquente, mais mesurée : les responsables européens ont condamné la décision américaine, la jugeant illégale au regard des règles de l'OMC, et ont évoqué la possibilité de déposer un différend devant l'OMC (la Chine a déjà intenté une action en justice contre les droits de douane américains). Cependant, les procédures devant l'OMC prennent du temps et les droits de douane américains, justifiés par une « urgence nationale », se situent dans une zone grise du droit international. Si le processus de l'OMC est jugé inefficace, davantage de pays pourraient simplement imposer leurs propres droits de douane plutôt que de s'en remettre à un jugement.
Relocalisation et découplage : L’un des principaux effets attendus des droits de douane est de « relocaliser » la production, c’est-à-dire de rapatrier la production aux États-Unis. Ce phénomène se produira, surtout si les droits de douane semblent perdurer. Les entreprises produisant des biens lourds ou volumineux (dont les coûts de transport et les droits de douane rendent l’importation prohibitive) pourraient délocaliser leur production aux États-Unis. Par exemple, certains fabricants d’appareils électroménagers et de meubles pourraient décider qu’il est désormais économique de fabriquer ces articles aux États-Unis pour éviter une taxe à l’importation de 10 à 20 %. L’administration vante une analyse selon laquelle un droit de douane mondial de 10 % (bien inférieur à ce qui est actuellement appliqué) pourrait créer 2,8 millions d’emplois aux États-Unis et accroître le PIB, mais de nombreux économistes sont sceptiques face à ces prévisions optimistes, notamment compte tenu des représailles et de la hausse des coûts des intrants. Les contraintes pratiques – disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée, délais de construction des usines, obstacles réglementaires – signifient que la relocalisation sera, au mieux, progressive. de pourraient voir le jour aux États-Unis (notamment dans des secteurs comme les pièces automobiles, le textile ou l'assemblage électronique), ce qui n'aurait pas eu lieu autrement. Cela s'inscrit dans l'objectif de l'administration d'une chaîne d'approvisionnement plus autonome pour les biens essentiels (comme en témoignent les récentes politiques de subvention à la production nationale de puces). Mais il est douteux que cela compense les pertes d'efficacité et les pertes de débouchés à l'exportation.
Stratégies logistiques et de gestion des stocks : Entre-temps, de nombreuses entreprises s’adapteront en modifiant leur logistique. Nous avons vu des importateurs approvisionner leurs stocks en amont (importer des marchandises avant l’entrée en vigueur des droits de douane), mais cette méthode ne fonctionne qu’une seule fois et entraîne une accalmie ultérieure. Les entreprises peuvent également utiliser des entrepôts sous douane ou des zones franches aux États-Unis pour différer les droits de douane jusqu’à ce que les marchandises soient réellement nécessaires. Certaines pourraient réacheminer leurs marchandises via des pays bénéficiant d’accords commerciaux favorables (bien que les règles d’origine empêchent tout simple transbordement). En résumé, les entreprises mondiales passeront les deux prochaines années à réinventer leurs chaînes d’approvisionnement afin de les optimiser dans un environnement de droits de douane élevés, une tâche qu’elles n’ont pas eu à accomplir à cette échelle depuis des décennies. Cela pourrait entraîner des inefficacités importantes, comme le déplacement d’une usine non pas parce que c’est l’emplacement le moins cher ou le plus avantageux, mais uniquement pour éviter un droit de douane. De telles distorsions peuvent réduire la productivité à l’échelle mondiale.
Potentiel d'accords commerciaux : L'un des facteurs imprévisibles est que le choc tarifaire pourrait contraindre les pays à revenir à la table des négociations. Trump a suggéré que les droits de douane constituent un levier pour obtenir de « meilleurs accords ». Il est possible qu'entre 2025 et 2027, des négociations bilatérales aient lieu, au cours desquelles certains droits de douane seraient levés en échange de concessions. Par exemple, l'UE et les États-Unis pourraient négocier un accord sectoriel visant à réduire les droits de douane de 20 % si l'UE répond à certaines préoccupations américaines (par exemple sur l'automobile ou l'accès aux marchés agricoles). Il est également question que le Royaume-Uni et d'autres pays cherchent à obtenir des exemptions en s'alignant sur les objectifs stratégiques des États-Unis. La fiche d'information mentionne que les droits de douane pourraient être abaissés si les partenaires « remédient aux accords commerciaux non réciproques et s'alignent sur les États-Unis sur les questions économiques et de sécurité nationale » . Cela implique que les États-Unis sont ouverts à une réduction des droits de douane pour les pays qui, par exemple, augmentent leurs dépenses de défense (exigences de l'OTAN), se joignent aux sanctions américaines contre leurs adversaires ou ouvrent leurs marchés aux produits américains. Ainsi, les chaînes d'approvisionnement pourraient également réagir aux évolutions politiques : si certains pays concluent des accords pour échapper aux droits de douane, les entreprises privilégieront ces pays pour s'approvisionner. Reste à voir si de tels accords se concrétisent ; d'ici là, l'incertitude règne.
Globalement, d'ici 2027, nous anticipons un système commercial mondial plus fragmenté . Les chaînes d'approvisionnement seront davantage centrées sur les marchés nationaux ou régionaux, la redondance sera intégrée (afin d'éviter la dépendance à un seul pays) et la croissance du commerce mondial sera probablement plus faible qu'elle ne l'aurait été. L'économie mondiale pourrait se réorganiser autour de la réalité d'une Amérique protectionniste, au moins pendant la durée du mandat de Trump, ce qui pourrait avoir des conséquences durables au-delà. Les gains d'efficacité de l'ancien système – l'approvisionnement mondial en flux tendus depuis le lieu le moins cher – cèdent la place à un nouveau paradigme de chaînes d'approvisionnement « au cas où » qui privilégient la résilience et l'évitement des droits de douane. Cela se traduit par une hausse des prix et une perte de croissance, comme l'ont souligné de nombreuses sources : selon Fitch, « l'augmentation moyenne des droits de douane à 22 % » est si importante que de nombreux pays exportateurs pourraient être précipités dans la récession, et même les États-Unis fonctionneront avec une efficacité moindre.
Réactions des partenaires commerciaux et conséquences géopolitiques
La réaction internationale à l'annonce de Trump concernant les droits de douane a été rapide et directe. Les partenaires commerciaux des États-Unis ont généralement condamné cette décision et pris des mesures de rétorsion , faisant planer le spectre d'une escalade de la guerre commerciale aux implications géopolitiques majeures.
Chine : Principale cible des droits de douane américains, la Chine a riposté en conséquence, et même plus. Pékin a réagi en imposant un droit de douane de 34 % sur toutes les importations de marchandises américaines , à compter du 10 avril 2025. Il s’agit d’une contre-mesure tarifaire radicale destinée à refléter la mesure américaine, excluant ainsi de nombreux produits américains du marché chinois, sauf baisse des prix ou absorption des droits de douane. De plus, la Chine a pris une série de mesures punitives allant au-delà des droits de douane : elle a intenté une action en justice auprès de l’OMC, contestant les droits de douane américains, les qualifiant de violations des règles du commerce international. Dans un langage cinglant, le ministère chinois du Commerce a accusé les États-Unis de « gravement porter atteinte au système commercial multilatéral fondé sur des règles » et de se livrer à une « intimidation unilatérale ». Bien qu’une procédure devant l’OMC puisse prendre des années, cela témoigne de la volonté de la Chine de mobiliser l’opinion mondiale contre la décision américaine.
Les représailles chinoises ont également utilisé des outils asymétriques, comme évoqué précédemment : renforcement des contrôles à l’exportation des terres rares , essentielles à la technologie américaine, interdiction d’entrée sur le marché de certaines entreprises américaines via sa liste des « entités non fiables » et lancement d’enquêtes réglementaires contre des entreprises américaines en Chine. La Chine a même eu recours à des barrières non tarifaires , comme l’arrêt brutal des importations de certains produits agricoles américains pour des motifs réglementaires (par exemple, en invoquant la détection de substances interdites ou de parasites dans des expéditions américaines). Toutes ces mesures indiquent que la Chine est prête à infliger des souffrances aux exportateurs américains et à jouer la carte de la fermeté. Sur le plan géopolitique, cela aggrave encore les relations déjà tendues entre les États-Unis et la Chine. Il est toutefois intéressant de noter que les canaux diplomatiques ne sont pas totalement rompus ; il a été noté que des responsables militaires américains et chinois ont tenu des discussions sur la sécurité maritime, même en pleine guerre douanière, ce qui signifie que les deux parties pourraient, dans une certaine mesure, compartimenter les questions commerciales des autres enjeux stratégiques.
Canada et Mexique : Les voisins des États-Unis et leurs partenaires de l'ALENA/AEUMC ont réagi avec un mélange de représailles et de prudence. Le Canada a adopté une position ferme : le premier ministre Justin Trudeau a annoncé l'imposition de droits de douane sur plus de 100 milliards de dollars de marchandises américaines en 21 jours. Cela couvre vraisemblablement un large éventail de produits ; une mesure immédiate du Canada a été d'imposer un droit de douane de 25 % sur les automobiles fabriquées aux États-Unis non conformes à l'AEUMC (pour contrer les droits de douane sur les automobiles de Trump). De plus, certaines provinces canadiennes ont pris des mesures symboliques, comme le retrait de l'alcool américain des rayons des magasins d'alcool (la LCBO de l'Ontario a cessé de stocker du whisky américain, comme le montrent les images de travailleurs retirant du whisky américain des rayons à Toronto en signe de protestation ). Ces mesures soulignent la stratégie canadienne de représailles à la fois économiques et symboliques, tout en mobilisant le soutien du public. Parallèlement, le Canada s'est coordonné avec d'autres alliés et cherche probablement à obtenir réparation par des moyens juridiques (le Canada appuiera les contestations devant l'OMC). Il convient de noter que les représailles du Canada sont calibrées : elles ont ciblé des exportations américaines politiquement sensibles (comme le whisky du Kentucky ou les produits agricoles du Midwest) pour faire pression sur les dirigeants américains afin qu'ils reconsidèrent leur position, faisant écho aux tactiques utilisées lors du conflit de 2018.
Le Mexique , sous la présidence de Claudia Sheinbaum, a également déclaré qu'il riposterait par des droits de douane sur les produits américains. Mais le Mexique s'est montré un peu plus hésitant : Sheinbaum a retardé l'annonce d'objectifs spécifiques jusqu'au week-end (après l'annonce initiale), laissant entendre que le Mexique espérait négocier ou éviter une confrontation totale. Cela est probablement dû au fait que l'économie mexicaine est fortement liée aux États-Unis (80 % de ses exportations sont destinées aux États-Unis) et qu'une guerre commerciale pourrait être gravement dommageable. Néanmoins, le Mexique ne peut se permettre de ne pas réagir du tout, politiquement parlant. On peut s'attendre à ce que le Mexique impose des droits de douane sur certaines exportations américaines comme le maïs, les céréales ou la viande (comme il l'a fait à plus petite échelle lors de différends passés) – mais peut-être aussi à rechercher le dialogue pour exempter certaines industries. Le Mexique tente simultanément d'attirer des investissements tandis que les entreprises repensent leurs chaînes d'approvisionnement (se positionnant comme un bénéficiaire de la délocalisation de proximité). La réaction du Mexique est donc un mélange de représailles et de mesures de proximité : il ripostera pour satisfaire ses exigences nationales de dignité et de réciprocité, mais il pourrait se garder de la poudre aux yeux dans l'espoir d'un compromis. Il est à noter que le Mexique a coopéré avec les États-Unis sur d'autres fronts (comme le contrôle des migrations) ; Sheinbaum pourrait s'en servir comme monnaie d'échange pour obtenir un allègement tarifaire.
Union européenne et autres alliés : L’UE a vivement critiqué les droits de douane imposés par Trump. Les dirigeants européens ont qualifié les actions américaines d’injustifiées, et le commissaire européen au Commerce s’est engagé à réagir « fermement mais de manière proportionnée ». La liste initiale de représailles de l’UE (si elle est mise en œuvre) pourrait s’inspirer de l’approche adoptée en 2018 : cibler des produits américains emblématiques tels que les motos Harley-Davidson, le bourbon, les jeans et les produits agricoles (fromage, jus d’orange, etc.). On évoque la possibilité que l’UE impose environ 20 milliards d’euros de droits de douane sur les marchandises américaines , correspondant à l’impact commercial. Cependant, l’UE tente également d’engager des négociations avec les États-Unis, peut-être pour relancer les discussions sur un accord commercial limité ou pour répondre aux griefs sans déclencher une guerre commerciale ouverte. L’Europe est dans une impasse : elle partage certaines inquiétudes des États-Unis concernant les pratiques commerciales de la Chine, mais se retrouve désormais également pénalisée par les droits de douane américains. Sur le plan géopolitique, cela a provoqué des frictions au sein de l’alliance occidentale . Selon certaines informations, des responsables européens auraient rejeté les demandes américaines sur des sujets sans rapport (comme l'augmentation des dépenses de défense) suite à la décision sur les droits de douane, y voyant une forme de pression américaine. Si le conflit commercial s'éternise, il pourrait se transformer en coopération stratégique, par exemple en rendant l'Europe moins encline à suivre l'exemple américain sur les questions de politique étrangère, ou en perturbant les efforts coordonnés (comme l'imposition de sanctions à des pays tiers). L'unité occidentale est déjà mise à l'épreuve : un titre indiquait que l'Europe et le Canada renforceraient leur défense, mais « restent réticents face aux exigences américaines » , une allusion indirecte à la façon dont le conflit tarifaire envenime les relations plus larges.
D'autres alliés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie ont également protesté. La Corée du Sud a été confrontée non seulement à des droits de douane, mais aussi à une crise politique sans rapport (l'AP a noté que le président sud-coréen a été destitué en pleine tourmente, ce qui pourrait être une coïncidence ou en partie provoqué par des difficultés économiques). Les droits de douane de 24 % imposés par le Japon sont importants : le Japon a indiqué qu'il pourrait augmenter les droits de douane sur le bœuf américain et d'autres importations en représailles, mais en tant qu'allié proche en matière de sécurité, il s'efforcera de maintenir de bonnes relations. L'Australie, moins directement touchée (léger déficit commercial avec les États-Unis), a critiqué la dégradation des règles du commerce mondial. De nombreux pays se coordonnent probablement au sein de forums comme le G20 ou l'APEC pour exhorter collectivement les États-Unis à changer de cap, soulignant ainsi le risque pour la croissance mondiale.
Pays en développement : L’impact sur les économies en développement est un aspect notable. De nombreux pays émergents (Inde, Vietnam, Indonésie, etc.) ont été frappés par des droits de douane américains élevés, malgré leur faible importance. Cela a suscité de vives critiques : l’Inde a qualifié ces droits de douane d’« unis et injustes » et a laissé entendre qu’elle augmenterait ses propres droits de douane sur des produits américains comme les motos et les produits agricoles (elle l’a déjà fait par le passé). Les pays d’Afrique et d’Amérique latine craignent que ces droits de douane ne freinent leurs exportations et ne dévastatrices pour des secteurs comme le textile au Bangladesh ou le cacao en Afrique de l’Ouest. L’analyse du Peterson Institute soutient que les droits de douane imposés par Trump pourraient « paralyser les économies en développement » qui dépendent des exportations vers les États-Unis, car ils dépassent largement les niveaux de ces pays et ignorent leurs limites économiques. Cela a un coût géopolitique : cela nuit à la position et à l’influence des États-Unis dans les pays en développement . En effet, parallèlement aux hausses de droits de douane, l’administration Trump a réduit l’aide étrangère, une combinaison susceptible d’alimenter le ressentiment. Les pays qui se sentent sous pression pourraient chercher à se rapprocher de la Chine ou d’autres puissances offrant un partenariat économique alternatif. Par exemple, si les pays africains voient le marché américain se fermer, ils pourraient se tourner davantage vers l’Europe ou vers l’initiative chinoise « Ceinture et Route » pour leur croissance.
Réalignements géopolitiques : Les droits de douane ne se produisent pas en vase clos ; ils s'inscrivent dans des courants géopolitiques plus larges. La rivalité sino-américaine s'intensifie sur les plans économique et militaire. Cette guerre commerciale pourrait accélérer la scission du monde en deux sphères économiques : l'une centrée sur les États-Unis, l'autre sur la Chine. Les nations pourraient être contraintes de choisir leur camp ou d'aligner leurs politiques économiques en conséquence. Les États-Unis ont explicitement lié l'allègement tarifaire à l'alignement des nations sur les « questions économiques et de sécurité nationale », impliquant une contrepartie : soutenir les positions américaines sur des questions telles que l'isolement de certains adversaires pourrait permettre d'obtenir de meilleures conditions commerciales. Certains y voient une façon pour les États-Unis d'exploiter leur puissance commerciale pour atteindre des objectifs stratégiques (par exemple, en proposant éventuellement des droits de douane plus bas à l'UE ou à l'Inde si elles rejoignent la position américaine contre les ambitions technologiques de la Chine ou contre la Russie, etc.). Reste à savoir si cette stratégie sera couronnée de succès ou se retournera contre elles. À court terme, le climat géopolitique est marqué par une tension et une méfiance accrues , les États-Unis étant perçus comme usant unilatéralement de leur puissance économique.
Institutions internationales : Cette salve de droits de douane fragilise également les institutions commerciales mondiales comme l’OMC. Si l’OMC ne parvient pas à trancher efficacement ce différend (et les États-Unis bloquent les nominations à l’organe d’appel de l’OMC, l’affaiblissant ainsi), les pays pourraient recourir de plus en plus à une gestion commerciale fondée sur le pouvoir plutôt que sur les règles. Cela pourrait éroder l’ordre économique international de l’après-Seconde Guerre mondiale. Les alliés qui travaillaient traditionnellement au sein de l’OMC envisagent désormais des arrangements ad hoc ou des mini-accords latéraux pour faire face à la situation. En effet, les actions de Trump pourraient inciter d’autres pays à former de nouvelles coalitions ou de nouveaux accords commerciaux excluant les États-Unis pour l’instant, espérant ainsi patienter.
En résumé, les réactions aux droits de douane imposés par Trump ont été universellement négatives parmi les partenaires commerciaux, ce qui a entraîné une escalade des représailles. Les conséquences géopolitiques incluent des alliances tendues, un resserrement des liens entre rivaux américains, un affaiblissement des normes commerciales multilatérales et des tensions économiques dans les régions en développement. Cette situation présente les caractéristiques d'une guerre commerciale classique : chaque camp haussant la barre avec de nouveaux droits de douane ou restrictions. Si cette situation n'est pas résolue, nous pourrions assister d'ici 2027 à un paysage géopolitique profondément modifié, où les différends commerciaux se répercutent sur les partenariats stratégiques et où les États-Unis se sont, intentionnellement ou non, retirés de leur rôle de leader dans la gouvernance économique mondiale.
Un employé de la LCBO de Toronto retire du whisky américain des rayons (4 mars 2025), alors que le Canada riposte aux tarifs douaniers américains en interdisant certains produits américains. Ces gestes symboliques témoignent de la colère des alliés et des conséquences de la guerre commerciale sur les consommateurs.
Impact sur le marché du travail et les consommateurs
Emplois et marché du travail : Les droits de douane auront des effets complexes et spécifiques à chaque région sur l’emploi. À court terme, des créations d’emplois pourraient se produire dans les secteurs protégés, mais des pertes d’emplois plus importantes sont probables dans les secteurs confrontés à des coûts plus élevés ou à des barrières à l’exportation. Le président Trump a promis que ces droits de douane « rameneront des usines et des emplois » aux États-Unis. Des embauches ont effectivement été annoncées : quelques aciéries à l’arrêt prévoient de redémarrer, créant potentiellement quelques milliers d’emplois dans les villes sidérurgiques ; une usine d’électroménager de l’Ohio, qui peinait à concurrencer les importations, prévoit de recruter du personnel maintenant que ses concurrents importés sont confrontés à des droits de douane. Il s’agit d’avantages tangibles concentrés dans certaines zones industrielles – des victoires politiques importantes que l’administration soulignera.
Cependant, ces gains étant contrebalancés par les droits de douane, d'autres entreprises suppriment des emplois ou abandonnent leurs projets d'embauche. Les entreprises qui dépendent des intrants importés ou des revenus d'exportation verront leurs bénéfices se réduire, et nombre d'entre elles réagissent en réduisant leurs coûts de main-d'œuvre. Par exemple, un fabricant d'équipement agricole du Midwest a annoncé des licenciements, invoquant la hausse du coût de l'acier (son intrant) et la baisse des commandes à l'exportation en provenance du Canada (son marché). Dans le secteur agricole, si les revenus agricoles baissent, il y a moins d'argent à consacrer à la main-d'œuvre et aux services ; les travailleurs saisonniers pourraient trouver moins d'opportunités. Les détaillants pourraient également se replier : les grandes surfaces anticipent une baisse de leurs ventes une fois les hausses de prix effectives, ce qui conduit certaines d'entre elles à ralentir les embauches, voire à fermer des magasins à marge réduite. Le PDG de Target a souligné que les ventes étaient déjà au ralenti, les consommateurs étant de plus en plus méfiants, et que les droits de douane exerçant une « pression » supplémentaire, cela laisse présager de potentielles réductions de coûts à venir.
Au niveau macroéconomique, le chômage pourrait légèrement augmenter par rapport à ses plus bas niveaux actuels. Le taux de chômage américain était d'environ 4,1 % début 2025 ; certaines prévisions le voient désormais dépasser 5 % en 2026 si l'économie ralentit comme prévu. Les États et les secteurs sensibles aux échanges commerciaux en subiront les conséquences les plus lourdes. En particulier, les États de la ceinture agricole (Iowa, Illinois, Nebraska) et les États fortement exportateurs de produits manufacturés (Michigan, Caroline du Sud) pourraient connaître des pertes d'emplois supérieures à la moyenne. Selon une estimation de la Tax Foundation, l'ensemble des mesures commerciales de Trump pourrait à terme réduire l'emploi aux États-Unis de plusieurs centaines de milliers d'emplois (ils estimaient auparavant à environ 300 000 le nombre d'emplois perdus suite aux droits de douane de 2018 ; les droits de douane de 2025 ont une portée plus importante). À l'inverse, les États dont les industries sont en concurrence avec les importations (comme l'acier en Pennsylvanie ou le meuble en Caroline du Nord) pourraient connaître une légère hausse de l'emploi. Il y a aussi l'angle gouvernemental et militaire : si les États-Unis se tournent vers les achats nationaux en matière de défense et d'infrastructures en raison du nationalisme économique, certains emplois pourraient être créés dans ces domaines (même si c'est indirect).
Les salaires pourraient également être affectés. Dans les secteurs soumis à des droits de douane protectionnistes, les entreprises pourraient avoir un plus grand pouvoir de fixation des prix et pourraient potentiellement augmenter les salaires pour attirer les travailleurs (par exemple, si les usines augmentent leurs activités). Mais dans l'ensemble de l'économie, toute inflation stimulée par les droits de douane érodera les salaires réels, à moins que les salaires nominaux n'augmentent en conséquence. Si, comme prévu, le chômage augmente et que l'économie ralentit, les travailleurs auront moins de pouvoir de négociation pour obtenir des augmentations. Il pourrait en résulter une stagnation, voire une baisse, des salaires réels pour de nombreux Américains, en particulier les travailleurs à faibles et moyens revenus qui consacrent une part importante de leurs revenus aux biens de consommation concernés.
Consommateurs – Prix et choix : Les consommateurs américains sont sans doute les plus grands perdants de l'équation tarifaire, du moins à court terme. Ces droits de douane fonctionnent comme une taxe que les consommateurs finissent par payer sur les biens importés. Comme indiqué précédemment, les prix de nombreux produits du quotidien sont appelés à augmenter. Selon un calcul réalisé fin 2024 (date à laquelle ces droits de douane ont été proposés), un ménage américain moyen pourrait finir par payer environ 1 000 dollars de plus par an pour ses biens si le coût total des droits de douane était répercuté. Cela comprend la hausse des prix d'articles tels que les téléphones, les ordinateurs, les vêtements, les jouets, les appareils électroménagers et même les produits alimentaires de base contenant des composants ou des ingrédients importés.
Nous constatons déjà des conséquences immédiates pour les consommateurs : les ruptures de stock et la thésaurisation des détaillants pourraient entraîner des pénuries ou des retards temporaires. Certains consommateurs se sont précipités pour acheter des articles importés coûteux (comme des voitures ou des appareils électroniques) avant l’entrée en vigueur des droits de douane, ce qui pourrait être suivi d’une accalmie de la consommation due à une hausse des prix. Les analystes du commerce de détail préviennent que les remises seront plus difficiles à obtenir : les magasins qui pratiquent habituellement des soldes pourraient réduire leurs dépenses, leurs marges étant désormais plus faibles. De fait, les indices de confiance des consommateurs ont chuté en avril, les enquêtes montrant que les consommateurs anticipent une hausse de l’inflation et considèrent que le moment est mal choisi pour effectuer des achats importants, en grande partie en raison de l’annonce des droits de douane.
Les consommateurs à faibles revenus seront particulièrement touchés, car ils consacrent une part plus importante de leurs revenus à des biens (plutôt qu'à des services) et à des produits de première nécessité qui pourraient désormais coûter plus cher. Par exemple, les détaillants à bas prix importent beaucoup de vêtements et d'articles ménagers bon marché ; une hausse de prix de 10 à 20 % sur ces produits impacte beaucoup plus durement une famille vivant d'un salaire à l'autre qu'une famille plus aisée. De plus, si des pertes d'emploi se matérialisent dans certains secteurs, les travailleurs concernés réduiront leurs dépenses, ce qui aura un effet domino sur les économies locales.
Changements de comportement des consommateurs : Face à la hausse des prix, les consommateurs peuvent modifier leur comportement : acheter moins, se tourner vers des substituts moins chers ou reporter leurs achats. Par exemple, si le prix des baskets importées augmente, les consommateurs pourraient opter pour des marques inconnues ou simplement se contenter de leurs vieilles chaussures plus longtemps. Si les jouets sont plus chers, les parents pourraient en acheter moins ou se tourner vers les marchés d’occasion. Globalement, cette baisse de la demande peut atténuer quelque peu l’impact de l’inflation (le volume des ventes pourrait diminuer), mais elle se traduit également par une baisse du niveau de vie, les consommateurs recevant moins pour le même prix.
Il existe également un impact psychologique : le conflit commercial, largement médiatisé, et les turbulences boursières qui en résultent peuvent miner la confiance des consommateurs. Si les consommateurs craignent une dégradation de la conjoncture économique (annonces de chutes boursières, etc.), ils pourraient réduire leurs dépenses de manière proactive, ce qui peut devenir un frein à la croissance.
Côté positif pour les consommateurs, si la guerre commerciale entraîne un ralentissement économique significatif, comme mentionné précédemment, la Réserve fédérale pourrait baisser ses taux d'intérêt. Cela pourrait profiter aux consommateurs grâce à des crédits moins chers ; par exemple, les taux hypothécaires ont déjà baissé en raison des craintes de récession. Ceux qui recherchent un prêt immobilier ou automobile pourraient bénéficier de taux légèrement plus avantageux qu'auparavant. Cependant, un crédit plus facile ne compensera pas entièrement la hausse des prix des biens : il s'agit d'un coût d'emprunt et d'un coût de consommation.
Filets de sécurité et réponse politique : Le gouvernement pourrait prendre des mesures d’atténuation pour protéger les consommateurs et les travailleurs. Des réductions d’impôts ou une augmentation des allocations chômage sont évoquées si la situation s’aggrave. Lors des précédentes mesures tarifaires, le gouvernement a apporté une aide aux agriculteurs ; cette fois-ci, une aide plus large pourrait être envisagée, même si cela reste hypothétique. Sur le plan politique, des pressions seront exercées pour aider les populations touchées par les droits de douane (par exemple, un fonds fédéral pour subventionner les importations essentielles comme les dispositifs médicaux afin de maîtriser les coûts des soins de santé, ou une aide ciblée pour les ménages à faibles revenus confrontés à la hausse des prix).
D'ici 2027, l'espoir (du point de vue de l'administration) est que les consommateurs bénéficient d'une économie nationale plus forte, avec davantage d'emplois et des salaires en hausse, compensant ainsi la hausse des prix. Cependant, la plupart des économistes doutent que ce résultat se matérialise à si court terme. Il est plus probable que les consommateurs s'adapteront en adoptant de nouvelles habitudes de consommation – peut-être davantage de « acheter américain » si les producteurs nationaux se mobilisent, mais souvent à des prix plus élevés. Si les droits de douane perdurent, la concurrence intérieure pourrait s'intensifier (plus d'entreprises américaines fabriquent des produits = potentiel de concurrence sur les prix), mais le développement de cette capacité prend du temps et il est peu probable qu'il remplace entièrement les importations à bas prix perdues d'ici deux ans.
En résumé, les consommateurs américains sont confrontés à une période d'ajustement marquée par l'inflation des prix et une baisse du pouvoir d'achat , tandis que le marché du travail est en pleine mutation : certains emplois reviennent dans des niches protégées, mais davantage d'emplois sont menacés dans les secteurs exposés aux échanges commerciaux. Si la guerre commerciale devait faire basculer l'économie dans la récession, les pertes d'emplois se propageraient largement, impactant davantage la consommation. Les décideurs politiques devront alors peser le pour et le contre : les avantages escomptés des droits de douane pour certains travailleurs par rapport aux conséquences plus larges pour les consommateurs et les autres travailleurs. La section suivante examinera les implications pour l'investissement et les marchés financiers, qui influencent également l'emploi et le bien-être des consommateurs.
Conséquences des investissements à court et à long terme
Le choc tarifaire a déjà ébranlé les marchés financiers et influencera les décisions d’investissement à court et à long terme.
Réaction des marchés financiers à court terme : Les investisseurs ont réagi rapidement à l’annonce des droits de douane avec une réaction classique d’aversion au risque. Les marchés boursiers américains et mondiaux ont chuté sous l’effet de l’escalade des craintes d’une guerre commerciale. Le lendemain de l’annonce des représailles chinoises, les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de plus de 1 000 points et, à la clôture du marché ce jour-là, le Dow et le S&P 500 avaient enregistré leur pire chute depuis des années. Les valeurs technologiques, qui dépendent des chaînes d’approvisionnement mondiales et des marchés chinois, ont été particulièrement touchées ; le NASDAQ a chuté encore plus fortement en pourcentage. Les actions des grandes multinationales (par exemple, Apple, Boeing, Caterpillar) ont plongé en raison des inquiétudes concernant la hausse des coûts et les pertes de ventes. Parallèlement, les secteurs considérés comme « sûrs » ou à l’abri des droits de douane (services publics, entreprises de services axées sur le marché intérieur) ont mieux résisté. Les indices de volatilité ont grimpé en flèche , reflétant l’incertitude.
Les investisseurs se sont également rués vers la sécurité des obligations d'État, entraînant une baisse des rendements (comme mentionné précédemment, les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont chuté, inversant une partie de la courbe des taux – souvent un signal de récession). Le prix de l'or a également augmenté, signe supplémentaire d'une fuite vers la sécurité. Sur les marchés des changes, le dollar américain s'est d'abord renforcé face aux devises des marchés émergents (les investisseurs mondiaux recherchant la sécurité des actifs en dollars), mais il est intéressant de noter qu'il s'est affaibli face au yen japonais et au franc suisse (valeurs refuges traditionnelles). Le yuan chinois s'est déprécié face au dollar, ce qui pourrait compenser une partie de l'impact des droits de douane (un yuan moins cher rend les exportations chinoises moins chères), bien que les autorités chinoises aient géré cette baisse pour éviter l'instabilité financière.
À court terme (les 6 à 12 prochains mois) , on peut s'attendre à ce que les marchés financiers restent volatils, sensibles à chaque nouvelle évolution de la guerre commerciale. Les marchés réagiront de manière inégale aux discussions sur des négociations ou de nouvelles représailles. En cas de signes de compromis, les actions pourraient rebondir. si l'escalade se poursuit (par exemple, si les États-Unis## Implications pour les investissements à court et à long terme
Turbulences sur les marchés à court terme : La conséquence immédiate de l'annonce des tarifs douaniers a été une volatilité accrue sur les marchés financiers. Les investisseurs, craignant une guerre commerciale à grande échelle et un ralentissement mondial, sont passés à une position défensive. Les indices boursiers américains ont plongé à la nouvelle - par exemple, le Dow Jones a chuté de plus de 1 100 points le 4 avril en réaction aux représailles de la Chine - et les marchés boursiers du monde entier ont suivi le mouvement. Les secteurs directement exposés au commerce ont subi de lourdes pertes : les géants industriels, les entreprises technologiques et les entreprises dépendant des intrants importés ou des ventes chinoises ont vu le cours de leurs actions chuter. Les actifs refuges, en revanche, ont rebondi : les obligations du Trésor américain étaient très demandées (faisant baisser les rendements) et les prix de l'or ont augmenté. La fuite vers la qualité reflète la crainte que les bénéfices des entreprises ne pâtissent des tarifs douaniers et que la croissance mondiale ne s'affaiblisse, ce qui augmente à son tour le risque de récession. En effet, les contrats à terme sur actions américaines et les marchés mondiaux ont fluctué à chaque nouveau tarif ou titre de représailles, indiquant que le sentiment des investisseurs est étroitement lié à l’évolution de la guerre commerciale.
Les analystes financiers constatent une dégradation de la confiance des entreprises . Les droits de douane ajoutent incertitude et risque à la planification des entreprises, poussant nombre d'entre elles à reconsidérer ou à reporter leurs dépenses d'investissement. À court terme, cela se traduit par une baisse des investissements dans de nouvelles usines, de nouveaux équipements ou des projets d'expansion, ce qui freine la croissance. Par exemple, une enquête menée par la Business Roundtable en avril 2025 a révélé une forte baisse des perspectives économiques des PDG, nombre d'entre eux invoquant la politique commerciale comme motif de réduction des investissements. De même, les indices de confiance des petites entreprises ont chuté, les petits importateurs/exportateurs s'inquiétant des ruptures d'approvisionnement et des flambées des coûts.
Tendances d’investissement à long terme : Au cours des deux prochaines années, si les tarifs restent en place, nous pourrions assister à une réaffectation significative des investissements entre les secteurs et les régions :
-
Dépenses d'investissement nationales : Certaines industries augmenteront leurs investissements nationaux pour tirer parti des droits de douane protecteurs. Par exemple, les constructeurs automobiles étrangers pourraient investir dans des usines d'assemblage américaines afin d'éviter les droits de douane de 25 % sur les voitures (des rapports indiquent déjà que les constructeurs automobiles européens et asiatiques accélèrent leurs projets de construction de véhicules en Amérique du Nord). De même, les entreprises américaines de secteurs comme l'acier, l'aluminium ou l'électroménager pourraient investir dans la réouverture ou l'agrandissement de leurs installations, pariant sur le fait que les droits de douane freineront la concurrence. La Maison-Blanche présente cela comme une victoire – la réorientation des investissements vers les États-Unis – et il y aura effectivement des hausses ciblées des dépenses d'investissement dans les industries protégées. L'industrie sidérurgique, par exemple, a annoncé des investissements prévus d'environ 1 milliard de dollars dans plusieurs usines, invoquant un environnement tarifaire favorable.
-
Réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales : À l'inverse, les multinationales pourraient investir dans la reconfiguration de leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine ou d'autres pays à droits de douane élevés. Cela pourrait profiter à certains marchés émergents ou alliés. Par exemple, les entreprises pourraient investir dans la production manufacturière en Inde ou en Indonésie (confrontées à des droits de douane américains inférieurs à ceux de la Chine) ou au Mexique/Canada (afin de tirer parti du libre-échange de l'AEUMC en Amérique du Nord). Certains pays d'Asie du Sud-Est non spécifiquement pénalisés pourraient voir de nouvelles usines s'implanter, les entreprises cherchant des solutions de contournement tarifaire. Cependant, comme indiqué précédemment, l'ampleur des droits de douane américains limite les options : il n'existe pas de refuge évident pour les pays à faibles droits de douane, sauf peut-être en Amérique du Nord. Cette incertitude pourrait même décourager l'investissement direct étranger (IDE) dans son ensemble : pourquoi construire une usine à l'étranger si la future politique américaine risque d'imposer des droits de douane à ce pays ? Le Peterson Institute prévient que des droits de douane aussi élevés décourageront l'investissement dans les économies en développement, nuisant potentiellement irrémédiablement à leurs perspectives de croissance et limitant ainsi les opportunités pour les investisseurs internationaux. En d'autres termes, un régime tarifaire prolongé pourrait entraîner une baisse durable des flux d'investissement transfrontaliers, inversant ainsi des décennies de mondialisation.
-
Stratégie d'entreprise et fusions-acquisitions : Les entreprises pourraient réagir par des fusions ou des acquisitions afin d'internaliser leurs chaînes d'approvisionnement et de réduire leur exposition aux droits de douane. Par exemple, un fabricant américain pourrait acquérir un fournisseur national plutôt que d'importer des pièces, ou une entreprise étrangère pourrait acquérir une entreprise américaine pour produire derrière le mur tarifaire. On pourrait assister à une vague d' acquisitions par « arbitrage tarifaire » , où les entreprises restructurent leur capital pour exploiter d'éventuelles exemptions tarifaires (bien que la réglementation puisse limiter les mouvements évidents). De plus, les secteurs confrontés à une pression sur les marges pourraient se consolider ; les acteurs les plus faibles pourraient être rachetés ou faire faillite. Le secteur agricole, par exemple, pourrait connaître une consolidation si les petites exploitations ne parviennent pas à survivre aux pertes à l'exportation, ce qui pourrait inciter les investisseurs agroalimentaires à acheter des actifs en difficulté. Globalement, les investissements favoriseront les entreprises capables de s'adapter au nouvel environnement commercial ou d'en tirer parti, tandis que celles qui ne parviennent pas à s'adapter pourraient avoir du mal à attirer des capitaux.
-
Investissements publics et politiques : Du côté du gouvernement, les priorités d’investissement public pourraient évoluer. Le gouvernement américain pourrait investir davantage dans les infrastructures ou le soutien industriel afin de renforcer les capacités nationales (par exemple, en augmentant les subventions aux usines de semi-conducteurs ou à l’extraction de matériaux critiques pour réduire la dépendance aux importations). En cas de ralentissement économique, on ne peut pas non plus exclure des mesures de relance budgétaire (qui constituent une forme d’investissement dans l’économie). Du point de vue des investisseurs, cela pourrait ouvrir des opportunités dans les secteurs liés aux marchés publics ou aux dépenses d’infrastructure, compensant en partie la prudence du secteur privé.
Pour les investisseurs financiers (institutionnels et particuliers), le contexte 2025-2027 sera probablement caractérisé par un risque accru et une rotation sectorielle prudente . Nombre d'entre eux réorientent déjà leurs portefeuilles en prévision d'un ralentissement de la croissance : ils privilégient les valeurs défensives (santé, services aux collectivités), les entreprises dont le chiffre d'affaires est principalement national ou celles qui peuvent facilement répercuter leurs coûts. Les entreprises exportatrices et dépendantes des importations procèdent à des désinvestissements. Par ailleurs, les investisseurs surveillent l'évolution des devises : si les tensions commerciales persistent, certains anticipent un affaiblissement du dollar américain (les déficits commerciaux pourraient initialement se creuser et d'autres pays riposter, réduisant ainsi la demande de dollars), ce qui impacterait alors les rendements des investissements dans diverses classes d'actifs.
En résumé, le climat d'investissement à long terme est marqué par l'incertitude et l'adaptation . Certains investissements se réorienteront pour tirer parti de la structure tarifaire (renforçant la production nationale dans certains secteurs), mais l'investissement global des entreprises risque d'être inférieur à ce qu'il aurait été dans un régime commercial stable. La guerre commerciale agit comme une taxe sur le capital en augmentant le coût des affaires internationales et en accentuant l'incertitude. D'ici 2027, l'effet cumulé pourrait se traduire par quelques années d'investissements perdus dans des projets pourtant productifs – un coût d'opportunité qui pourrait se traduire par un ralentissement de la croissance de la productivité. Les investisseurs, quant à eux, continueront d'exiger des éclaircissements : une trêve ou un accord commercial durable déclencherait probablement une reprise de l'investissement, tandis qu'un conflit commercial enraciné maintiendrait les dépenses d'investissement à un niveau modéré et les marchés volatils.
Perspectives politiques et parallèles historiques
Les droits de douane imposés par Trump en avril 2025 marquent l'aboutissement d'un virage protectionniste de la politique commerciale américaine amorcé dès son premier mandat. Ils rappellent des époques antérieures de droits de douane élevés, bénéficiant à la fois du soutien des nationalistes économiques et des vives critiques des partisans du libre-échange. Historiquement, la dernière fois que les États-Unis ont imposé des droits de douane aussi largement punitifs remonte à l' arrêt Smoot-Hawley de 1930 , qui a augmenté les droits de douane sur des milliers d'importations. À l'époque comme aujourd'hui, l'objectif était de protéger les industries nationales, mais le résultat a été des droits de douane de rétorsion à l'échelle mondiale qui ont réduit le commerce mondial et aggravé la Grande Dépression. Les analystes ont invoqué à plusieurs reprises l'arrêt Smoot-Hawley comme un parallèle édifiant : alors que les droits de douane américains approchent désormais les niveaux des années 1930, le risque de voir cette histoire se répéter est grandissant .
Cependant, il existe aussi des parallèles historiques plus récents. Dans les années 1980, les États-Unis ont eu recours à des mesures commerciales agressives (droits de douane, quotas d'importation et restrictions volontaires des exportations) pour corriger les déséquilibres commerciaux avec le Japon et d'autres pays – par exemple, des droits de douane sur les motos japonaises pour sauver Harley-Davidson, ou des quotas sur les voitures japonaises. Ces mesures ont connu un succès mitigé et ont finalement été réduites par la négociation (comme l'accord du Plaza sur les devises ou les accords sur les semi-conducteurs). La stratégie de Trump pour 2025 est bien plus ambitieuse, mais l'idée sous-jacente est similaire à la position commerciale « America First » des années 1980. Les politiques commerciales actuelles de l'administration Trump s'appuient également sur la guerre commerciale limitée de 2018-2019, lorsque des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et 360 milliards de dollars de marchandises chinoises ont été imposés. À l'époque, la confrontation a conduit à une trêve partielle – l'accord de phase 1 de janvier 2020 avec la Chine, où la Chine a accepté d'acheter davantage de produits américains (un objectif qu'elle a largement manqué) en échange de l'absence de nouveaux droits de douane. De nombreux observateurs soulignent que l'accord de phase 1 n'a pas résolu les problèmes fondamentaux tels que les subventions chinoises ou les pratiques « non marchandes ». Les nouveaux droits de douane de 2025 témoignent de la conviction de la Maison-Blanche que seule une approche beaucoup plus radicale (taxer tous les produits, et pas seulement certains) permettra d'imposer des changements structurels. En ce sens, on peut parler de « guerre commerciale 2.0 » : une escalade après que les politiques précédentes ont été jugées insuffisantes .
D'un point de vue politique, ces droits de douane marquent également une rupture avec le consensus multilatéral sur le libre-échange qui a dominé des années 1990 à 2016. Même après le départ de Trump en 2021, son successeur n'a que partiellement réduit les droits de douane ; aujourd'hui, en 2025, Trump a doublé la mise, suggérant une évolution durable de la politique commerciale américaine vers un scepticisme à l'égard du libre-échange. Qu'il s'agisse d'un changement permanent ou d'une aberration temporaire dépendra des résultats politiques (les prochaines élections pourraient apporter des philosophies différentes). Mais à court terme, les États-Unis ont de fait mis l'OMC à l'écart (en agissant unilatéralement) et privilégié les rapports de force bilatéraux. Les pays du monde entier s'adaptent à cette nouvelle réalité, comme expliqué dans la section géopolitique.
L'histoire nous enseigne qu'il est plus facile de déclencher des guerres commerciales que de les arrêter. Une fois les droits de douane et les contre-droits de douane accumulés, les groupes d'intérêt des deux camps s'adaptent et font souvent pression pour les maintenir (certaines industries américaines bénéficieront d'une protection et résisteront à un retour à la libre concurrence, tandis que les producteurs étrangers trouveront d'autres marchés et pourraient ne pas se précipiter pour revenir). Cependant, un autre enseignement est que les graves difficultés économiques causées par les guerres commerciales peuvent à terme pousser les dirigeants à revenir à la table des négociations. Par exemple, après deux ans de politiques de type Smoot-Hawley, le président Franklin D. Roosevelt a fait marche arrière en concluant des accords commerciaux réciproques en 1934. Il est possible que si les droits de douane provoquent des ravages (par exemple, en cas de récession importante ou de crise financière), les États-Unis pourraient chercher d'ici 2026-2027 des solutions de contournement, soit par le biais de nouveaux accords commerciaux, soit au moins d'exemptions sélectives. Un courant politique sous-jacent existe déjà : le Congrès a techniquement le pouvoir de réviser ou de limiter les droits de douane, et bien que le parti du président le soutienne majoritairement actuellement, une crise économique prolongée pourrait modifier ce calcul.
Débats politiques en cours : Les droits de douane s’inscrivent également dans les débats sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement (rendus urgents par la pandémie et les rivalités géopolitiques). Même les opposants à la méthode de Trump reconnaissent qu’une diversification hors de Chine ou un renforcement des capacités nationales sont prudents. On observe ainsi un chevauchement entre politique commerciale et politique industrielle : les droits de douane s’accompagnent d’efforts visant à encourager la production nationale de semi-conducteurs, de batteries pour véhicules électriques, de produits pharmaceutiques, etc. À cet égard, les droits de douane constituent un outil d’une stratégie plus large de « découplage » avec les adversaires et de promotion des chaînes d’approvisionnement alliées . Cela concorde également avec les initiatives d’autres pays (l’Europe discute d’« autonomie stratégique », l’Inde s’efforce d’être autonome, etc.). Ainsi, bien qu’extrêmes dans leur mise en œuvre, les droits de douane de Trump font écho à une remise en question mondiale de la dépendance excessive à l’égard de partenaires commerciaux uniques. Historiquement, cela rappelle les blocs commerciaux mercantilistes ou de l’époque de la Guerre froide, où l’alignement géopolitique dictait les relations commerciales. Nous entrons peut-être dans une période où les modèles commerciaux reflètent davantage les alliances politiques que la pure logique du marché.
En conclusion, les droits de douane d'avril 2025 marquent un tournant majeur dans la politique commerciale – un retour au protectionnisme inédit depuis des générations. Les impacts attendus sur la période 2025-2027, tels qu'analysés précédemment, sont globalement négatifs pour la croissance mondiale et la stabilité des marchés, avec quelques légers avantages pour certaines industries nationales. La situation reste fluctuante : beaucoup dépendra de la réaction des autres nations (nouvelle escalade ou négociation) et de la résilience de l'économie américaine face à ces tensions. L'examen des précédents historiques et des tendances actuelles incite à la prudence : les guerres commerciales ont toujours été des situations perdantes pour tous , et une impasse prolongée pourrait aggraver la situation économique de toutes les parties. Le défi pour les décideurs politiques sera de trouver une issue – un règlement négocié ou un ajustement des politiques – qui réponde aux enjeux commerciaux légitimes sans nuire durablement à l'ordre économique international. D'ici là, les entreprises, les consommateurs et les gouvernements du monde entier traverseront une nouvelle ère de droits de douane élevés et d'incertitude accrue, espérant que les prochaines années apporteront clarté et stabilisation aux relations commerciales mondiales.
Conclusion
Les droits de douane annoncés par le président Trump le 3 avril 2025 marquent un tournant dans les relations commerciales des États-Unis, inaugurant l'un des régimes protectionnistes les plus étendus de l'histoire moderne. Cette analyse a exploré les répercussions multiformes attendues jusqu'en 2027 :
-
Résumé : Un droit de douane général de 10 % et des droits de douane nationaux beaucoup plus élevés (34 % pour la Chine, 20 % pour l'UE, etc.) affectent désormais la quasi-totalité des importations américaines, avec seulement quelques exceptions. Ces mesures, justifiées par l'administration comme nécessaires à un commerce « équitable » et réciproque, ont bouleversé le statu quo du commerce mondial.
-
Effets macroéconomiques : Il est généralement admis que ces droits de douane freineront la croissance et feront grimper l’inflation aux États-Unis et dans le monde. Les experts avertissent déjà que les niveaux des droits de douane se rapprochent de ceux qui ont « aggravé la Grande Dépression » et que de nombreuses économies pourraient sombrer dans la récession si les droits de douane persistent. Les consommateurs américains sont confrontés à une hausse des prix des biens de consommation courante, ce qui mine leur pouvoir d’achat et complique la gestion de l’inflation par la Réserve fédérale.
-
Impacts sectoriels : L’industrie manufacturière traditionnelle et certains secteurs des ressources pourraient bénéficier d’une protection à court terme et potentiellement créer des emplois ou accroître la production derrière le mur tarifaire. Cependant, les industries qui dépendent des chaînes d’approvisionnement mondiales (automobile, technologie, agriculture) subissent des bouleversements, une hausse des coûts des intrants et une perte de marchés d’exportation. Les agriculteurs, en particulier, sont touchés par des droits de douane de rétorsion qui ferment des marchés clés comme la Chine, entraînant une offre excédentaire et une baisse des revenus. Les entreprises technologiques sont confrontées à des goulets d’étranglement de l’approvisionnement et à des contre-mesures stratégiques (comme les contrôles chinois sur les exportations de terres rares) susceptibles de perturber la production de produits de haute technologie. Le secteur de l’énergie a été partiellement protégé par des exemptions, mais les exportateurs d’énergie américains souffrent des droits de douane étrangers et du ralentissement économique général.
-
Chaînes d'approvisionnement et structures commerciales : Les réseaux d'approvisionnement mondiaux sont en pleine reconfiguration. Les entreprises cherchent des moyens de contourner les droits de douane en réorientant leurs sources d'approvisionnement et leur production, mais les options sont limitées compte tenu de l'ampleur des mesures américaines. Le résultat probable est une évolution vers des chaînes d'approvisionnement plus régionalisées et confinées au niveau national, sacrifiant l'efficacité à la sécurité. La croissance du commerce international devrait stagner, voire décliner, et se fragmenter en blocs commerciaux. Ces droits de douane pourraient bien accélérer le découplage entre les réseaux centrés sur les États-Unis et la Chine, et inciter d'autres pays à renforcer leurs liens entre eux en l'absence d'ouverture du marché américain.
-
Réactions internationales : Les partenaires commerciaux des États-Unis ont unanimement condamné les droits de douane et riposté avec vigueur. La Chine a égalé les droits de douane et est allée plus loin en imposant des restrictions à l’exportation et en engageant des poursuites devant l’OMC. Des alliés comme le Canada et l’UE ont imposé leurs propres droits de douane sur les produits américains et explorent des voies diplomatiques et juridiques pour y répondre. Il en résulte une escalade du protectionnisme qui risque d’envenimer les relations géopolitiques. Le système commercial fondé sur des règles, sous l’égide de l’OMC, est confronté à l’une de ses plus graves épreuves, et le leadership mondial en matière de commerce est en pleine mutation.
-
Travail et consommateurs : Si un sous-ensemble d’emplois dans les secteurs protégés pourrait être rétabli, de nombreux autres sont menacés dans les secteurs exportateurs et dépendants des importations. Les consommateurs en paient finalement le prix par une hausse des coûts – une taxe qui pourrait s’élever en moyenne à plusieurs centaines de dollars par personne et par an. Les droits de douane sont régressifs et impactent principalement les ménages à faibles revenus, en raison du coût plus élevé des produits de première nécessité. Si l’économie se contracte, le marché du travail pourrait s’affaiblir, érodant une partie du pouvoir de négociation acquis par les travailleurs ces dernières années.
-
Climat d'investissement : À court terme, les marchés financiers ont réagi négativement, avec des actions en baisse et une volatilité en hausse dans un contexte d'incertitude commerciale. Les entreprises reportent leurs investissements en raison de règles du jeu floues. À long terme, certains investissements seront réorientés pour tirer parti des droits de douane (projets nationaux) ou les éviter (nouvelles chaînes d'approvisionnement dans différents pays), mais les dépenses d'investissement globales devraient être inférieures dans un scénario de guerre commerciale prolongée, ce qui pèsera sur la croissance et l'innovation futures.
-
Contexte politique et historique : Ces droits de douane représentent un changement radical de la politique américaine par rapport au consensus libre-échangiste des décennies précédentes, reflétant une résurgence du nationalisme économique. Historiquement, de tels épisodes de droits de douane élevés (par exemple, dans les années 1930) se sont mal terminés, et la situation actuelle est semée d’embûches similaires. Ces droits de douane recoupent des objectifs stratégiques – de la lutte contre les pratiques commerciales de la Chine à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement essentielles –, mais atteindre ces objectifs sans infliger de préjudice économique majeur demeure un défi de taille. Les deux prochaines années permettront de déterminer si le recours audacieux aux droits de douane peut effectivement déboucher sur des concessions négociées (comme le souhaite Trump), ou si cela entraînera une guerre commerciale perdante pour tous, nécessitant un changement de politique.
En conclusion, les droits de douane annoncés pour avril 2025 sont sur le point de remodeler en profondeur le paysage des marchés mondiaux et américains. Dans le meilleur des cas , ils pourraient entraîner des réformes des politiques des partenaires commerciaux et un rééquilibrage de certaines relations commerciales, même si cela implique des difficultés à court terme. Dans le pire des cas , ils pourraient déclencher un cycle de représailles et de contraction économique rappelant les guerres commerciales historiques, aggravant la situation de toutes les parties. La réalité se situera probablement entre les deux : une période d’ajustement important avec des gagnants et des perdants. Il est clair que les entreprises et les consommateurs du monde entier entrent dans une nouvelle ère de barrières commerciales plus strictes, avec toutes les conséquences que cela implique pour les prix, les profits et la prospérité. À mesure que la situation évolue, les décideurs politiques seront confrontés à une pression croissante pour atténuer les impacts négatifs, que ce soit par des mesures d’aide ciblées, un assouplissement monétaire ou, à terme, une résolution diplomatique du conflit commercial. En attendant qu’une telle résolution soit trouvée, l’économie mondiale doit se préparer à une route turbulente, en gérant les conséquences complexes de la stratégie tarifaire du président Trump pour 2025.
Sources : L’analyse ci-dessus repose sur des informations et des prévisions provenant de diverses sources récentes, notamment des articles de presse, des analyses économiques d’experts et des déclarations officielles. Parmi les principales références figurent les rapports de l’Associated Press sur l’annonce des droits de douane et les réactions internationales, la fiche d’information de la Maison-Blanche sur cette politique, les analyses de groupes de réflexion sur ses implications plus larges, ainsi que les données et citations initiales de dirigeants du secteur et d’économistes évaluant l’impact. L’ensemble de ces sources fournit une base factuelle pour évaluer les résultats attendus de l’expérimentation tarifaire 2025-2027.
Articles que vous aimeriez peut-être lire après celui-ci :
🔗 Les métiers que l'IA ne peut pas remplacer – et quels métiers
remplacera- t-elle ? Une perspective mondiale sur l'impact de l'IA sur l'emploi . Découvrez les professions qui résistent encore à l'IA et celles où l'automatisation est la plus susceptible de perturber le marché du travail.
🔗 L'IA peut-elle prédire le marché boursier ?
Un examen approfondi du potentiel, des limites et des préoccupations éthiques de l'utilisation de l'IA dans les prévisions financières.
🔗 Sur quoi l'IA générative peut-elle compter
sans intervention humaine ? Ce livre blanc analyse les domaines dans lesquels l'IA générative est fiable et ceux où la supervision humaine reste essentielle.